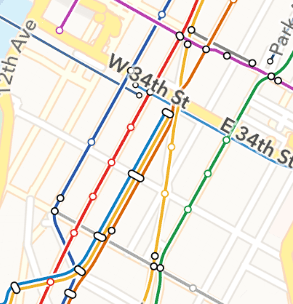Après s’être rendu à la justice au terme de trente ans de cavale, cet homme de 57 ans, tout à tour chanteur du groupe Camera Silens et braqueur, est jugé, mercredi 6 juin, à Toulouse, pour le casse d’un dépôt de la Brink’s, en 1988.
Ce matin-là, un orage de printemps a transformé les rues de Toulouse en rizières. Sous la pluie battante, au milieu de la foule des employés de bureau qui se presse, l’ancien chanteur du groupe punk Camera Silens s’avance d’un pas ankylosé. Sa capuche bat au vent, son grand corps trop maigre a l’air de flotter. A 57 ans, Gilles Bertin semble égaré parmi tous ces gens qui n’ont pas une seconde à perdre. Il a dilapidé tellement plus que cela…
Démarche d’échassier, il a l’air d’un type émergeant d’une nuit sans fin. La sienne a duré trente ans. Pour lui aussi, la période des crêtes et du « no future » est un souvenir lointain. Mais sa vie de damné ne lui a pas laissé le temps de refermer cette parenthèse de jeunesse. Et son passé n’a jamais cessé de le hanter, au Portugal, en Espagne et même ici, dans ce bistrot bondé de la place des Carmes où le bruit des conversations lui donne des maux de tête et où il ne peut s’empêcher de promener un regard anxieux sur les tables voisines, comme si toutes les polices d’Europe étaient encore à ses trousses.
Avec ses boucles blondes, ses larges lunettes qui lui barrent le visage pour compenser la perte de son œil gauche, éteint par une infection virale, il n’a pourtant plus grand-chose du chien fou qui jappait sa révolte en mordant les mollets des bourgeois. Il ressemble plutôt à un touriste allemand ou, mieux, au chanteur Dick Annegarn, ce barde folk du siècle dernier. Il a effacé les tatouages qui ornaient ses mains et le coin de ses yeux. Il semble presque étranger à la dévotion posthume que les fans de punk portent au groupe dont il fut autrefois la figure de proue. Ecoute-t-il seulement, de temps à autre, Pour la gloire, l’hymne de Camera Silens qui électrocuta la scène rock bordelaise au début des années 1980 ? Il sourit, un peu gêné. « Déjà, à l’époque, j’avais du mal… »
Grand escogriffe sorti des limbes
Punk et junky à 20 ans, gangster en cavale à 30, rescapé du sida à 40 et, désormais, repenti soucieux de mettre de l’ordre dans ce chaos intime, Gilles Bertin s’apprête à comparaître, le 6 juin, devant la cour d’assises de la Haute-Garonne pour le braquage du dépôt toulousain de la Brink’s, le 27 avril 1988. Un bail, donc. Condamné à dix ans de prison par contumace en 2004, donné pour disparu puis pour mort par l’administration française, il aurait pu réchauffer sa conscience une poignée d’années supplémentaires dans la chaleur de son foyer barcelonais, auprès de sa compagne Cécilia et de leur fils de 6 ans, Tiago, en attendant la prescription. Il a choisi de courir un dernier risque.
Muni d’un sac à dos et d’une valise de remords, il a franchi la frontière à pied, un jour de novembre 2016, puis il a pris le train pour Toulouse et il s’est rendu à la justice de son pays. Au fond de lui-même, il s’était préparé à cette scène-là depuis longtemps. Maintes et maintes fois, il s’était vu ressortir du palais de justice les menottes au poignet. Mais la juge des libertés et de la détention a dû être touchée par la sincérité de cet escogriffe sorti des limbes, vieux jeune homme timide poursuivi par une affaire presque oubliée de tous, puisqu’elle s’est contentée de le placer sous contrôle judiciaire dans l’attente de son procès. Il s’est retrouvé dans la rue, un peu sonné.
« J’étais persuadé de passer ma première nuit au ballon. Du coup, je ne savais même pas où dormir… »
Après avoir trouvé refuge ici ou là pendant plus d’un an, Gilles Bertin a fini par établir ses quartiers chez une tante éloignée, dans un pavillon au fin fond d’une impasse du fin fond d’un faubourg toulousain. Il vit dans une pièce éclairée au néon, en surplomb du garage, fait sa popote sur un réchaud de camping, repose son corps éreinté sur un sommier métallique. Ce n’est pas le Pérou, mais c’est bien mieux qu’à Bordeaux, le creuset de sa jeunesse et de sa gloire destructrice, où il a eu l’idée saugrenue de séjourner peu de temps après son retour en France.
Mort en 2010, selon l’administration
Le pote qui l’hébergeait lui rebattait tant les oreilles avec ses souvenirs d’ancien combattant que sa tension est montée en flèche et qu’il s’est mis à faire des crises d’angoisse. Et puis, sous les façades fraîchement ravalées et les ruelles pavées de frais du Bordeaux d’Alain Juppé, il ne reconnaissait pas sa ville, celle des squats du quartier Saint-Pierre et des bars miteux du cours de la Somme. « C’est l’horreur tellement c’est beau… », lâche-t-il avec la candeur d’un revenant dont la vie se serait arrêtée l’année où Le Grand Bleu cartonnait sur les écrans.
Depuis qu’il s’est mis à la disposition de la justice, voici dix-huit mois, sa situation est presque aussi bancale qu’au temps où il vivait dans la clandestinité. Il n’a plus rien de commun avec Didier Ballet, son nom d’emprunt durant toutes ces années, mais il n’est pas redevenu tout à fait Gilles Bertin. Après l’avoir fait mourir en 2010, l’administration peine à le ressusciter : il n’arrive toujours pas à obtenir ses papiers d’identité. Du coup, la moindre démarche est un casse-tête. « En même temps, s’ils veulent me juger, ils sont bien obligés de me remettre vivant », croit-il comprendre.
« SHOOTÉ, J’ÉTAIS UN ZOMBIE ; EN MANQUE, J’ÉTAIS CAPABLE DE FAIRE N’IMPORTE QUOI »
GILLES BERTIN
Pour s’y retrouver dans sa propre vie, il écrit le roman vrai d’un enfant du XXe siècle, un enfant terrible, au carrefour des années Guy Lux et du premier septennat de François Mitterrand. Une maison d’édition parisienne lui a signé un contrat ; un ami, presque un frère, Jean-Manuel Escarnot, correspondant de Libération à Toulouse, supervise l’avancée des travaux. « Heureusement que j’ai l’écriture pour tenir, sinon, je finirais par me demander ce que je fous là », note-t-il avec un pâle sourire qui éclaire sa peau mâchée par les hépatites à répétition.
Ces derniers temps, pourtant, il a ralenti la cadence. Son livre est un peu comme lui, en suspens, entre la France et l’Espagne, ses années de déglingue et son douloureux chemin vers la contrition. « Je bloque, je n’arrive plus à me concentrer. C’est l’angoisse du procès qui me noue les tripes. » La première partie, en revanche, lui est venue d’un seul jet. Net et sans bavure. Comme à l’époque de Camera Silens, où il jetait ses couplets sur un sous-bock, entre deux bières, au Chiquito : « Qui saura nous faire exploser/Qui vaincra pour s’exprimer/Tous unis pour réussir/Tous unis pour en finir/Pour la gloire, eh, eh ! »
« C’était comme ça sous Giscard »
En finir, oui. Au commencement, Gilles Bertin veut surtout tordre le cou à une enfance aussi enjouée qu’une complainte de Nana Mouskouri. A Paris, son père est fonctionnaire à l’Hôtel des monnaies ; sa mère, atteinte du cancer, enchaîne les dépressions. « Les seuls moments où l’on ressemblait à une famille vaguement heureuse, c’est quand on partait en vacances sur la Côte d’Azur, dans un camping du ministère des finances. Le reste du temps, on vivait repliés sur la maladie de maman. On ne voyait jamais personne. »
Il grandit dans ce huis clos pesant, d’abord à Orly, puis à Pessac, près de Bordeaux, lorsque l’Hôtel des monnaies déménage en Gironde. Le déracinement ne produit pas de miracle. Usé par son sacerdoce conjugal, son père est à cran et la scolarité chaotique de l’élève Bertin lui ouvre une autoroute vers le collège technique. Il est tout juste adolescent quand Michèle, sa sœur aînée, part suivre ses études de prof de gym à Paris. Elle était le seul rayon de soleil dans la maison. Dès lors, il ne sortira plus de sa chambre que pour se rendre à son atelier d’apprenti mécanicien et se brosser les dents.
Dans son antre, les disques s’empilent. Après s’être fait l’oreille sur le glam-rock d’Alice Cooper, Gilles Bertin saute dans la première vague punk venue d’Angleterre. Nous sommes en 1977. Les Clash, les Sex Pistols éclaboussent l’ordre établi. Une révélation. Meurtri par l’atmosphère de veillée funèbre qui l’escorte depuis l’enfance, il se dit qu’il y a urgence à renaître ailleurs. Vivre ou mourir, peut-être. Mais vite.
Il a 18 ans, un CAP de tourneur-fraiseur, une piaule dans le quartier Mériadeck. Il paye le loyer grâce à un petit job décroché pendant les vacances d’été. « C’était comme ça sous Giscard, on bossait deux mois et on avait presque droit à un an de chômage. » Très vite, pourtant, il passe l’essentiel de ses jours et de ses nuits avec une petite bande qui effraie les honnêtes gens de la place Gambetta. Tee-shirts déchirés, épingles à nourrice, blousons cloutés.
« Quelque chose d’animal »
Avec eux, il a trouvé sa nouvelle famille. Il décolore sa tignasse de paille en jaune fluo, fait graver une bombe siglée d’un A comme « anarchie » sur sa main gauche. Pour manger, on vole à l’étalage, pour dormir, on force une porte. Entre deux parties de rigolade, Gilles et ses frères de rue se défoncent avec ce qu’ils trouvent : le shit, la colle, les coupe-faim… No future ! L’attitude y est, pas encore la musique. Mais ça ne saurait tarder.
L’avantage avec le punk, c’est qu’on peut fonder un groupe en un claquement de doigt avec deux musiciens sur trois qui ne savent pas jouer d’un instrument. Camera Silens – du nom des cellules d’isolement où étaient emprisonnés les membres de l’organisation terroriste d’extrême gauche allemande Fraction armée rouge – voit le jour à l’été 1981, lors d’une fête où Gilles Bertin croise la route de Benoît Destriau et Philippe Schneiberger. Ce dernier assure à la batterie, Benoît grattouille la guitare, Gilles se dévoue pour la basse et le chant.
Pendant six mois, le groupe répète dans des caves, avant de partir à Londres pour Noël. Gilles a un pote, là-bas, Philippe Rose, qui squatte du côté de Vauxhall. Ensemble, ils se rendent à Leeds pour assister au festival punk Christmas on Earth. Sur scène, des groupes comme The Exploited, Sham 69, UK Subs… La crème du street-punk anglais, prolétaire, gueulard, belliqueux. Un vrai coup de foudre. Le style Camera Silens est né.
Dès sa première prestation, au tremplin Rockotone, à Bordeaux, le trio sorti de nulle part casse la baraque et décroche la palme, ex aequo avec Noir Désir. A la basse et au micro, Gilles Bertin n’est pas en manque de charisme face au jeune Bertrand Cantat. Torse nu dès la fin du premier morceau, vomissant illusions perdues et rêves de chaos de sa génération, il aimante tous les regards. « Il ne bougeait pas beaucoup, car il était très crispé sur ses accords de basse, mais il dégageait quelque chose d’animal », souligne Eric Ferrer qui, plus tard, intégrera le groupe pour pallier son absence. Une poignée de concerts suffit alors à figer l’image de Camera Silens : un groupe âpre, hors système, traînant dans son sillage une horde de punks prêts à semer le souk partout où ils pointent leurs Doc Martens.
« L’adrénaline plus que le fric »
Mais c’est loin, tout ça. Dans la mémoire de Gilles Bertin, les dates de concert, les souvenirs de pogos se mélangent comme dans un kaléidoscope aux couleurs défraîchies. Il a vécu tant d’autres vies… La seule chose dont il se souvient clairement, c’est qu’un ressort s’est cassé en lui au moment précis où le groupe accédait au gratin de la scène punk hexagonale. Invité au Chaos Festival, à Orléans, à l’automne 1984, Camera Silens se produit dans une atmosphère d’émeute face à un public presque exclusivement composé de skinheads descendus de la région parisienne. « Si j’avais fait tout ça, c’était aussi pour plaire aux filles. Pas pour jouer devant 2 000 crânes rasés qui se foutent sur la gueule. »
DÉBUT 1984, IL EST PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE CAMBRIOLAGE. UNE BELLE VILLA SUR LES BOULEVARDS. MANQUE DE POT, C’ÉTAIT LA MAISON D’UN JUGE
Déjà, il est en train de passer à autre chose. En début d’année, il a séjourné six mois derrière les barreaux après avoir été pris en flagrant délit de cambriolage. Une belle villa sur les boulevards. Manque de pot, c’était la maison d’un juge. En prison, il a décroché de l’héroïne. Ça faisait près de deux ans qu’il était tombé dedans. Un gramme par jour, minimum. « Shooté, j’étais un zombie ; en manque, j’étais capable de faire n’importe quoi. » A l’été 1984, sevré, à la dure, il retrouve sa place dans le groupe. Comme chanteur, uniquement. Eric Ferrer tient désormais la basse. Gilles pourrait se sentir plus léger ; c’est le contraire.
L’héroïne lui manque ; en concert, il ne s’éclate plus comme avant. Il cherche, presque malgré lui, une addiction de substitution. Elle va lui être offerte sur un plateau par Didier Bacheré, le roadie du groupe, et son beau-frère, José Gomez, alias « Inaki », un Basque proche des commandos autonomes anticapitalistes. Après avoir sévi dans le trafic de drogue, le duo s’apprête à monter au braquage. Gilles Bertin sent un délicieux frisson courir le long de son échine. « Plus que le fric, c’est l’adrénaline que je voulais par-dessus tout. » Désormais, quand il n’est pas sur les routes avec Camera Silens, il part à l’aventure avec ses deux complices. Il croit mener sa double vie en secret, mais il ne trompe pas grand monde. A l’époque, Jean-Marc Gouaux, le manager du groupe, est aussi organisateur de concerts et n’en sort pas toujours gagnant. Un soir de banqueroute, il croise Gilles dans le public. « Il te manque combien ? – 7 000 francs… – Tiens, les voila, mon pote ! »
Un coup rondement mené
Ses proches font mine de ne rien voir, pas la police. Au printemps 1986, après avoir cassé une bijouterie, à Nantes, le trio surprend une conversation sur son scanner. Les policiers sont sur leurs traces. Panique à bord. Quelques jours plus tard, Camera Silens doit se produire à Brest. Son chanteur oublie de se présenter au départ du bus. Il a juste livré un dernier couplet à ses collègues : « On se mettra en cavale/A pied ou à cheval/Et l’humeur vagabonde/On ira de l’autre côté du monde… » Pour Gilles Bertin, c’est le début de la fin.
Que fait-il durant les deux ans qui suivent ? Il se planque, déjà. A Bordeaux, puis à quelques encablures de Toulouse, dans une ferme où se côtoie une faune hétéroclite de punks, de proches de l’ETA, de militants des Sections carrément anti-Le Pen (Scalp) et de junkies. Il essaye d’avoir un embryon de vie de famille avec Nathalie, son premier amour, une jeune Bordelaise aux yeux très bleus, aux cheveux trop blonds, prisonnière de l’héroïne. Leur fils, Loris, est né au début de l’année 1986. Gilles cherche à les extirper de cet abîme. Il réussit à franchir la frontière espagnole et s’installe à Gijon pour travailler sur les marchés. Mais il ne parle pas la langue, Nathalie non plus, et son petit pactole a bien fondu. L’expérience tourne court. Retour en France.
Lors du procès d’assises de 2004, le casse du dépôt toulousain de la Brink’s, au printemps 1988, a été assimilé au fait d’arme d’une bande de marginaux qui n’avaient plus rien à perdre, car presque tous atteints du sida. Pour Gilles Bertin, c’est un raccourci. Lui, par exemple, n’a appris sa maladie que sept ans plus tard. « Ce qui est vrai, c’est qu’en l’espace de quelques mois, le sida était passé du statut de rumeur à celui de pandémie, explique-t-il. A Bordeaux, les premiers copains tombaient. Il régnait comme un état d’urgence. » Ça n’exclut pas la minutie.
Avec ses comparses braqueurs, dont les inévitables beaux-frères Didier et « Inaki », mais aussi Philippe Rose, le squatteur de Vauxhall, il ausculte les habitudes des employés de la Brink’s et la procédure d’ouverture de la chambre forte pendant près d’un an. Et le 27 avril 1988, tout se passe comme sur des roulettes. Le détenteur des codes d’ouverture est enlevé à son domicile, les employés sont neutralisés en douceur par de faux gendarmes, aucune détonation d’arme à feu ou d’explosif ne retentit. Butin : 11,7 millions de francs (environ 1,8 million d’euros) en espèces. Du travail de pro accompli par un escadron de losers. « Pour se déguiser, on avait acheté de vieux uniformes aux Puces de Saint-Ouen, et on les avait repeints en bleu », se souvient Gilles Bertin, presque ébahi.
« Des gangsters, j’en voyais passer tous les jours »
Commence alors sa deuxième vie. Ou sa troisième, on ne sait plus très bien. Il file en Espagne avec Philippe Rose. Il loue une villa de prince sur la Costa Brava, s’éclate à Ibiza au son nouveau de la musique électronique. Il rêve surtout de partir loin, en Australie ou en Argentine, avec Nathalie et Loris. Rose est chargé d’accueillir la jeune femme et son bambin à l’aéroport de Barcelone. Gilles suit le petit cortège à distance. Sage précaution : sa compagne et son fils sont filés par la Guardia Civil… Place de Catalogne, au point de rendez-vous, les policiers sont partout. Gilles achète un journal allemand, le déplie pour cacher son visage, s’approche des siens, donne l’alerte. Philippe Rose et lui détalent dans les rues adjacentes. Nathalie et Loris restent plantés là. Il ne reverra pas son fils pendant vingt-huit ans. Nathalie, elle, est morte du sida en 1994.
« EN THÉORIE, MON CLIENT RISQUE UNE PEINE DE VINGT ANS DE RÉCLUSION, MAIS IL Y A QUELQUES RAISONS DE SE MONTRER OPTIMISTE »
ME CHRISTIAN ETELIN, AVOCAT DE GILLES BERTIN
Pendant deux ans, il erre à travers l’Espagne dans de discrètes pensions de famille sous le nom d’emprunt de Didier Ballet. Entre-temps, Philippe Rose s’est fait arrêter à Valence alors qu’il s’apprêtait à braquer un dealer. Gilles l’a appris dans le journal. Il n’appelle plus la France, tous ses proches sont sur écoute.
« J’avais peur pour eux, pour moi. C’est pour ça que j’ai décidé de larguer les dernières amarres. »
Il finira par trouver un port d’attache. Elle s’appelle Cécilia. Ses parents tiennent un café à la périphérie de Barcelone, à Poligono Canyelles, un quartier populaire où s’entassent les ouvriers venus du sud de l’Espagne, un coupe-gorge dévasté par le trafic de drogue. Elle est étudiante en journalisme, brune, fougueuse, gauchiste. Et très amoureuse. Elle sait tout de Gilles depuis leur première rencontre. Ça ne la démonte pas. « Des gangsters, j’en voyais passer tous les jours dans le café de mes parents, souligne-t-elle. Pour moi, Gilles était à l’opposé de ça. C’est quelqu’un qui souffrait. »
Et ce n’est qu’un début. Pour l’heure, le couple décide de s’expatrier. Direction le Portugal. Le sac de toile dont Gilles Bertin ne se sépare jamais et qui, trois ans plus tôt, contenait l’équivalent de 350 000 euros, est désormais bien léger. Juste de quoi louer un petit appartement et un pas-de-porte dans une galerie commerçante du centre-ville de Lisbonne. « Cécilia s’est occupé de toutes les démarches, dit-il. Moi, je n’existais pas. » Très vite, leur boutique de disques vinyles attire le chaland grâce, notamment, aux imports qu’il demande à sa compagne d’aller chercher à Londres, une fois par mois. Pour autant, il ne crie pas victoire. Dès qu’il aperçoit une voiture immatriculée en France, son cœur s’accélère. Et quand Noir Désir vient jouer sur les docks de Lisbonne, il se terre chez lui pendant cinq jours de peur de croiser une tête connue.
« Dans la peau d’un tricheur »
Au départ, c’est un détail insignifiant, une mauvaise toux, une simple grippe. C’est ce qu’il croit. Sauf qu’elle dure six mois et qu’il est perclus de fièvre. Et quand un ami de Cécilia l’emmène aux urgences, il a déjà perdu près de trente kilos. Le médecin exige un test du sida. Positif. L’annonce lui est faite, de manière très solennelle, dans un salon où sont réunis tous les pontes de l’établissement. On lui tend des calmants et des somnifères. « En 1995, séropositif, ça signifiait qu’on était condamné à mort », rappelle-t-il.
Pendant deux ans, il repousse l’échéance, tant bien que mal. Alors qu’il n’a ni papier ni couverture sociale, les médecins de l’hôpital du Barreiro, une commune communiste de la périphérie de Lisbonne, lui administrent des traitements de riche. Il souffle comme un scaphandrier, un cytomégalovirus lui coûte son œil gauche, une neuropathie anesthésie ses jambes, mais il résiste jusqu’à l’arrivée des trithérapies. Il est sauvé. Et pourtant, il déprime. « Ce n’est pas évident, quand on se prépare à mourir, de revenir à la vie. »
Il est en piteux état, mais il est encore là, libre, quand tous les autres ont été fauchés par la justice ou la maladie : Philippe Rose, au placard pendant trois ans en Espagne puis en France, « Inaki », arrêté à un péage, mort du sida, Didier Bacheré idem… Il sait tout ça. Il lit les journaux français. Et sa cavale, au fil du temps, s’est alourdie de ce fardeau moral. « Parfois, je me sentais un peu dans la peau d’un tricheur… » Cécilia, seule détentrice de ses secrets, le soutient de toutes ses forces mais, au magasin, il erre comme un fantôme. Pour ne rien arranger, l’invasion des CD finit par avoir raison de leur petit commerce de vinyles.
Au début des années 2000, le couple revient à Barcelone pour reprendre le café des parents de Cécilia. Les horaires et la clientèle sont rudes, mais Gilles finit par comprendre l’argot du coin et à se fondre dans le paysage. Les années passent et sont presque ordinaires en comparaison des précédentes. Il est épuisé du matin au soir, et son traitement à l’interféron pour soigner une hépatite C n’arrange rien. Mais l’on s’habitue à tout, surtout lui. Quand naît le petit Tiago, en 2011, au terme d’une fécondation in vitro, ça pourrait presque être le bonheur. Presque.
Se rendre à la justice et à l’évidence
Depuis qu’il est revenu à Barcelone, Gilles a pris l’habitude d’appeler son père, une fois par an, depuis une cabine téléphonique. Besoin de renouer un lien. Tant pis pour le risque. En entendant la voix de son fils, la première fois, le vieil homme a eu du mal à masquer son émotion. Gilles, aussi, quand il a appris que sa mère était morte de son cancer depuis dix ans. Et puis, en 2010, la sonnerie a résonné dans le vide. Il a tout de suite compris. Il a raccroché tristement. Et, une fois de plus, il s’est maudit de mener cette vie où, à force de passer pour un autre, il s’était perdu lui-même.
Finalement, il s’est rendu à la justice comme on se rend à l’évidence. Il n’en menait pas large en passant la frontière, ce 17 novembre 2016, et encore moins quelques jours plus tard quand il a revu, pour la première fois, Loris, son fils, ce bout de chou de 31 ans… Les deux hommes se sont retrouvés dans un boui-boui à couscous, à Toulouse. Gilles ne savait pas par où commencer alors il lui a dit qu’il avait les mêmes yeux bleus que sa mère. Loris a souri d’un air timide, le même que le sien. « Merci papa », a-t-il soufflé presque naturellement. Pas de reproche. Pas de jugement. Ça, c’est l’affaire de la cour d’assises, quatorze ans après un premier procès organisé en son absence, qui avait tourné au fiasco : la plupart des policiers appelés à la barre étaient déjà à la retraite, les experts guère plus fringants, la moitié des accusés avaient été emportés par le sida au siècle précédent…
« Pour retrouver sa liberté d’homme, Gilles Bertin a pris le risque de la perdre, c’est admirable, avance son avocat, Christian Etelin. Le procès prévu pour s’étaler sur trois jours ne va durer qu’un seul. En théorie, mon client risque une peine de vingt ans de réclusion, mais il y a quelques raisons de se montrer optimiste… » C’est quoi, l’optimisme ? Gilles Bertin a oublié ce sentiment depuis si longtemps. Il revient de si loin. Dans le bistrot de la place des Carmes, il observe d’un air songeur la pluie sur la vitre. Tout à l’heure, il a appris qu’un organisateur de concert était prêt à débourser 20 000 euros pour la reformation de Camera Silens. Il a haussé les épaules comme s’il connaissait la chanson. Pour la gloire ? Eh, eh, répondit l’écho.