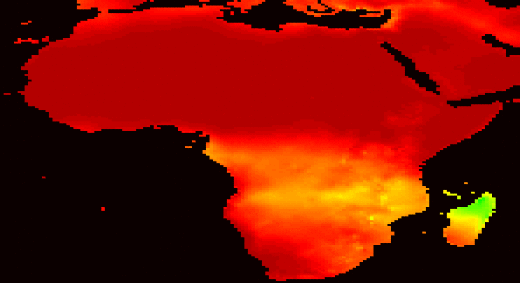Les chercheurs produisent et révisent gratuitement des articles publiés dans des journaux dont l’accès est ensuite facturé très cher aux organismes de recherche dont ils dépendent.
La crise sanitaire a mis les grands noms de l’édition scientifique sur le devant de la scène. Au début du mois de mars, la majorité des journaux scientifiques ont choisi de diffuser gratuitement les articles en lien avec le coronavirus, afin d’accélérer la recherche. Philanthropes ? Pas vraiment...
En temps normal, les connaissances scientifiques se monnaient très cher. Les quelques maisons d’édition qui possèdent l’essentiel de ces revues sont parmi les entreprises les plus rentables au monde, affichant des marges de 30 % à 40 %. C’est plus que le géant de l’informatique Apple, qui enregistre une marge de 21 % sur ces dix dernières années. Le secret des éditeurs scientifiques réside en grande partie dans le fait qu’ils vendent des produits obtenus sans dépenser un sou... ou presque. Au sein de la communauté scientifique, les voix sont de plus en plus nombreuses à dénoncer ce système, source de profits considérables au détriment des fonds publics. Jeudi, le prestigieux Institut de technologie du Massachusetts (MIT) annonçait ainsi mettre fin aux négociations avec le leader du secteur, Elsevier.
Le système est ainsi construit : un chercheur a tout intérêt à proposer des articles, puisque sa carrière (obtention d’un poste, de financements...) dépend étroitement du nombre d’articles qu’il publie et du prestige des journaux dans lesquels il publie. Lorsque le comité éditorial d’une revue est intéressé par un article qui lui a été proposé, il le soumet à des scientifiques spécialistes du domaine, qui sont chargés de l’évaluer. Ce travail essentiel, appelé « révision par les pairs » dans le jargon de l’édition scientifique, est réalisé bénévolement. Si l’article est accepté, le chercheur est alors contraint d’en céder les droits à l’éditeur, à titre exclusif et gracieux. L’entreprise revend ensuite aux bibliothèques universitaires et aux laboratoires de recherche des abonnements permettant d’accéder à ces articles. « Des personnes non rémunérées par l’éditeur produisent et évaluent gratuitement des résultats scientifiques que leurs institutions doivent ensuite acheter à l’éditeur » , résume Didier Torny, spécialiste de l’économie politique de la publication scientifique au CNRS. « Les profits arrivent ensuite dans la poche des actionnaires, c’est la poule aux oeufs d’or » , poursuit Marie Farge, mathématicienne et physicienne, directrice de recherche émérite au CNRS.
Le secteur se porte mieux que jamais. En 2018, le marché pesait 25,7 milliards de dollars, selon l’Association internationale des éditeurs scientifiques, contre 21 milliards de dollars en 2010. Elsevier (désormais RELX), qui possède plus de 2 500 revues dont The Lancet et Cell , affichait en 2019 un chiffre d’affaires de 7,87 milliards d’euros (dont un tiers provient de l’édition), soit 5 % de plus qu’en 2018. Un succès qui s’explique notamment par l’augmentation des montants facturés aux clients. Lors des négociations, le rapport de force n’est pas en faveur des bibliothèques. « Nous étions contents quand nous arrivions à négocier une hausse de 12 % au lieu de 15 % » , se souvient Bernard Rentier, recteur de l’université de Liège (Belgique) entre 2005 et 2014. « Si nous refusions le contrat, nous nous entendions dire que notre établissement allait devenir un petit trou de province, faute de pouvoir accéder à cette littérature , poursuit l’universitaire, auteur de Science ouverte, le défi de la transparence (Éditions de l’Académie royale de Belgique). Ce sont des requins assumés, mais je ne leur jette pas la pierre : ils ont pour oeuvre de gagner de l’argent. On ne peut que reprocher aux clients d’être clients. »
Actuellement, la France dépense environ 62 millions d’euros par an pour l’accès aux revues électroniques. Entre les années 1990 et 2018, la facture aurait augmenté annuellement de 2 % à 4 %, d’après une source proche du dossier. Mais il est difficile de le savoir précisément car la transparence n’est pas de mise. Jusqu’à récemment, les contrats noués entre Couperin (le consortium représentant plus de 250 acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche en France) et les éditeurs étaient confidentiels, à la demande de ces derniers. « Les négociations se font à la tête du client, et comme les contrats sont secrets, personne ne sait combien paient les autres » , dénonce Marie Farge. Pour la première fois en France, le contrat négocié avec la firme Elsevier en octobre 2019 a été divulgué officiellement (certains ont déjà fuité par le passé) : pendant quatre ans, 227 établissements de recherche et d’enseignement supérieur pourront accéder à 2 300 revues et services pour 34,7 millions d’euros par an en moyenne.
Pendant longtemps, les frais d’édition semblaient tout à fait justifiés et n’étaient pas remis en cause par la communauté scientifique. « Au moment de l’essor des revues spécialisées, au XIXe siècle, les sociétés savantes ont délégué le travail d’édition, d’impression et de diffusion à des libraires et des éditeurs , rapporte Valérie Tesnière, spécialiste des pratiques et politiques éditoriales scientifiques contemporaines à l’École des hautes études en sciences sociales. Le modèle économique a été conçu à un moment où les auteurs et les rédactions des journaux avaient bien du mal à écrire en anglais (pour les Européens) et à assurer les mises aux normes des données qui facilitent la circulation internationale de l’information. Les éditeurs ont fait payer ce service et plus il était performant, plus les marges ont été confortables, car un bon service se paie. »
Le développement d’internet aurait pu signer la fin de ce système, mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Et certains chercheurs estiment désormais que les prix pratiqués sont excessifs. « Bien sûr, il y a encore des frais liés aux serveurs, à la main-d’oeuvre, aux stockages des données , concède Laurette Tuckerman, physicienne à l’École supérieure de physique et de chimie industrielles à Paris, mais la distribution se fait désormais essentiellement par voie électronique et ce sont souvent les chercheurs eux-mêmes qui s’occupent de la mise en page. » « Les coûts ne sont pas si nuls , conteste Valérie Tesnière. Les éditeurs fournissent aussi d’autres services aux chercheurs. Ils assurent en outre une diffusion internationale, organisée et immédiate via des systèmes d’information élaborés, qui leur font gagner du temps. »
Mais l’escalade des prix s’explique en grande partie par un autre phénomène : la mise en place d’un oligopole, qui peut donc dicter à sa guise les lois du marché. « En trente ans, nous avons assisté à l’émergence de grands consortiums par fusions et acquisitions » , rapporte Bernard Rentier. Sur les quelque 12 000 éditeurs dans le monde, cinq se partagent 40 % du chiffre d’affaires. Autre raison de cette hausse spectaculaire, la nature des biens échangés. « En principe, si une entreprise vend un bien trop cher, les consommateurs vont se tourner vers ses concurrents. Mais en sciences, c’est impossible car les biens sont uniques » , explique Laurette Tuckerman. En économie, on parle de « demande inélastique » : la consommation n’est pas modifiée - ou très peu - par l’augmentation des prix. Cette spécificité du secteur n’est pas passée inaperçue aux yeux des investisseurs. Dès le début des années 2000, la banque d’investissement Morgan Stanley constatait que « la nature de niche du marché et la croissance rapide du budget des bibliothèques universitaires ont fait du marché de la publication scientifique le secteur de l’industrie des médias le plus florissant de ces quinze dernières années » .
Pour justifier ces hausses répétées des prix, les éditeurs se sont mis à proposer des bouquets de revues (les « big deals » ) à des tarifs plus intéressants que la vente à l’unité, puis à augmenter le nombre de revues (et donc d’articles). Plus récemment, ils ont développé une autre stratégie, calquée sur une idée chère à la communauté scientifique : l’accès libre, gratuit pour tous... sauf pour les auteurs. Depuis le milieu des années 2000, ils proposent aux chercheurs de payer des frais de publication (les Article Publishing Charges, ou APC) afin que leur travail soit diffusé gratuitement. « Les établissements de recherche déboursent deux fois , résume Florence Audier, chercheuse à l’université Panthéon-Sorbonne, dans un article publié en 2018 dans la revue La Vie de la recherche scientifique . D’un côté en payant les frais de publication open access et de l’autre en maintenant l’abonnement à ces mêmes revues. »
Si les frais d’abonnement commencent tout juste à s’infléchir - comme l’atteste la baisse des coûts de 13,3 % négociée lors du dernier contrat entre la France et Elsevier -, les APC connaissent une croissance très importante. D’après le consortium Couperin, les charges demandées par article par les éditeurs ont augmenté de 12 % en France entre 2015 et 2017, passant de 1 500 à 1 700 euros. Ces frais peuvent s’élever jusqu’à 7 000 dollars pour certains journaux. Des sommes souvent décorrélées des coûts de publication : « Les coûts réels pour publier un article uniquement en ligne peuvent être estimés entre 260 et 870 dollars, selon la qualité du travail d’édition et de relecture. Pour une version imprimée, c’est 1 300 à 2 000 dollars » , indique Samuel Alizon, directeur de recherche au CNRS. Pour Marie Farge, ces pratiques « relèvent plus du droit de péage que de la tarification de services apportés aux auteurs et aux lecteurs des articles publiés électroniquement » . Contacté par Le Figaro , Elsevier n’a pas répondu aux questions soulevées dans cet article.
Depuis une dizaine d’années, les initiatives se multiplient pour lutter contre ce système. Certains chercheurs refusent désormais de publier dans des revues commerciales ou de réviser les articles qui y sont soumis, des comités éditoriaux démissionnent pour protester contre l’augmentation des coûts de publication, et des bras de fer entre les éditeurs et les universités ont lieu un peu partout. Après tout, si les chercheurs quittaient la table des négociations, que deviendraient les éditeurs ?