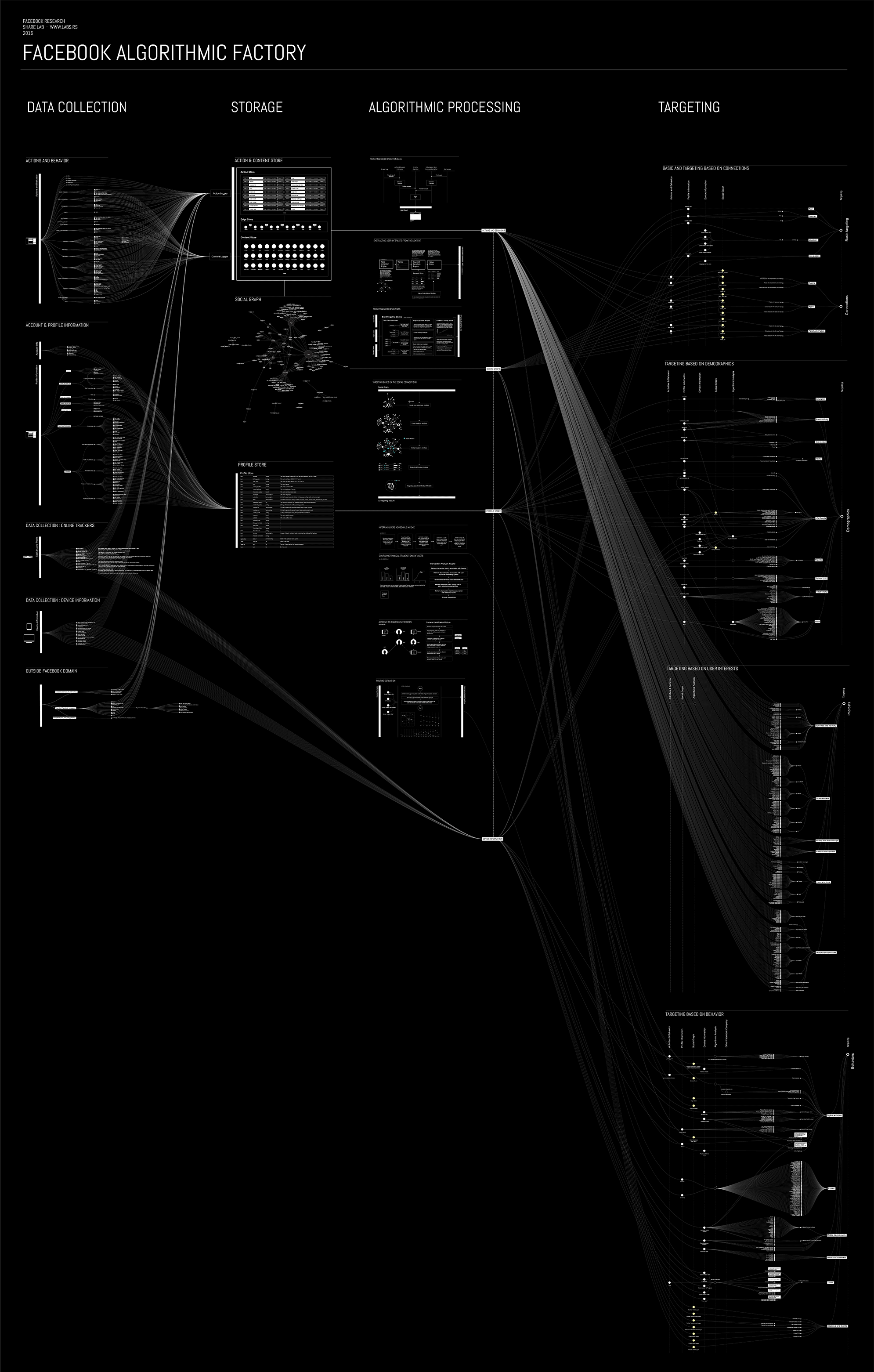En quelques semaines, le nouveau coronavirus dont l’humanité est devenue le principal hôte, s’est propagé aux quatre coins de la planète à une vitesse sans précédent, attestant de la densité des relations et des circulations humaines. Rapidement deux stratégies politiques se sont imposées : fermer les frontières nationales et confiner les populations.
Par un processus de #mimétisme_politique global, les gouvernements ont basculé en quelques jours d’une position minimisant le risque à des politiques publiques de plus en plus drastiques de contrôle puis de suspension des mobilités. Le recours systématique à la fermeture d’une limite administrative interroge : n’y a-t-il pas, comme répété dans un premier temps, un décalage entre la nature même de l’#épidémie et des frontières qui sont des productions politiques ? Le suivi de la diffusion virale ne nécessite-t-il un emboîtement d’échelles (famille, proches, réseaux de sociabilité et professionnels…) en deçà du cadre national ?
Nous nous proposons ici de revenir sur le phénomène sans précédent d’activation et de généralisation de l’appareil frontalier mondial, en commençant par retrouver la chronologie précise des fermetures successives. Bien que resserrée sur quelques jours, des phases se dessinent, pour aboutir à la situation présente de fermeture complète.
Il serait vain de vouloir donner une lecture uniforme de ce phénomène soudain mais nous partirons du constat que le phénomène de « frontiérisation du monde », pour parler comme Achille Mbembe, était déjà à l’œuvre au moment de l’irruption épidémique, avant de nous interroger sur son accélération, son aboutissement et sa réversibilité.
L’argument sanitaire
Alors que la présence du virus était attestée, à partir de février 2020, dans les différentes parties du monde, la fermeture des frontières nationales s’est imposée selon un principe de cohérence sanitaire, le risque d’importation du virus par des voyageurs était avéré. Le transport aérien a permis au virus de faire des sauts territoriaux révélant un premier archipel économique liant le Hubei au reste du monde avant de se diffuser au gré de mobilités multiples.
Pour autant, les réponses des premiers pays touchés, en l’occurrence la Chine et la Corée du Sud, se sont organisées autour de l’élévation de barrières non-nationales : personnes infectées mises en quarantaine, foyers, ilots, ville, province etc. L’articulation raisonnée de multiples échelles, l’identification et le ciblage des clusters, ont permis de contrôler la propagation du virus et d’en réduire fortement la létalité. A toutes ces échelles d’intervention s’ajoute l’échelle mondiale où s‘est organisée la réponse médicale par la recherche collective des traitements et des vaccins.
Face à la multiplication des foyers de contamination, la plupart des gouvernements ont fait le choix d’un repli national. La fermeture des frontières est apparue comme une modalité de reprise de contrôle politique et le retour aux sources de l’État souverain. Bien que nul dirigeant ne peut nier avoir agi « en retard », puisque aucun pays n’est exempt de cas de Covid-19, beaucoup d’États se réjouissent d’avoir fermé « à temps », avant que la vague n’engendre une catastrophe.
L’orchestration d’une réponse commune concertée notamment dans le cadre de l’OMS est abandonnée au profit d’initiatives unilatérales. La fermeture des frontières a transformé la pandémie en autant d’épidémies nationales, devenant par là un exemple paradigmatique du nationalisme méthodologique, pour reprendre les termes d’analyse d’Ulrich Beck.
S’impose alors la logique résidentielle : les citoyens présents sur un territoire deviennent comptables de la diffusion de l’épidémie et du maintien des capacités de prise en charge par le système médical. La dialectique entre gouvernants et gouvernés s’articule alors autour des décomptes quotidiens, de chiffres immédiatement comparés, bien que pas toujours commensurables, à ceux des pays voisins.
La frontiérisation du monde consécutive de la pandémie de coronavirus ne peut se résumer à la seule somme des fermetures particulières, pays par pays. Bien au contraire, des logiques collectives se laissent entrevoir. A défaut de concertation, les gouvernants ont fait l’expérience du dilemme du prisonnier.
Face à une opinion publique inquiète, un chef de gouvernement prenait le risque d’être considéré comme laxiste ou irresponsable en maintenant ses frontières ouvertes alors que les autres fermaient les leurs. Ces phénomènes mimétiques entre États se sont démultipliés en quelques jours face à la pandémie : les États ont redécouvert leur maîtrise biopolitique via les mesures barrières, ils ont défendu leur rationalité en suivant les avis de conseils scientifiques et en discréditant les approches émotionnelles ou religieuses ; ils ont privilégié la suspension des droits à grand renfort de mesures d’exception. Le risque global a alors légitimé la réaffirmation d’une autorité nationale dans un unanimisme relatif.
Chronologie de la soudaineté
La séquence vécue depuis la fin du mois janvier de l’année 2020 s’est traduite par une série d’accélérations venant renforcer les principes de fermeture des frontières. Le développement de l’épidémie en Chine alarme assez rapidement la communauté internationale et tout particulièrement les pays limitrophes.
La Corée du Nord prend les devants dès le 21 janvier en fermant sa frontière avec la Chine et interdit tout voyage touristique sur son sol. Alors que la Chine développe une stratégie de confinement ciblé dès le 23 janvier, les autres pays frontaliers ferment leurs frontières terrestres ou n’ouvrent pas leurs frontières saisonnières d’altitude comme le Pakistan.
Parallèlement, les pays non frontaliers entament une politique de fermeture des routes aériennes qui constituent autant de points potentiels d’entrée du virus. Cette procédure prend des formes différentes qui relèvent d’un gradient de diplomatie. Certains se contentent de demander aux compagnies aériennes nationales de suspendre leurs vols, fermant leur frontière de facto (Algérie, Égypte, Maroc, Rwanda, France, Canada, entre autres), d’autres privilégient l’approche plus frontale comme les États-Unis qui, le 2 février, interdisent leur territoire au voyageurs ayant séjournés en Chine.
La propagation très rapide de l’épidémie en Iran amène à une deuxième tentative de mise en quarantaine d’un pays dès le 20 février. Le rôle de l’Iran dans les circulations terrestres de l’Afghanistan à la Turquie pousse les gouvernements frontaliers à fermer les points de passage. De même, le gouvernement irakien étroitement lié à Téhéran finit par fermer la frontière le 20 février. Puis les voyageurs ayant séjourné en Iran sont à leur tour progressivement considérés comme indésirables. Les gouvernements décident alors de politiques d’interdiction de séjour ciblées ou de mises en quarantaine forcées par la création de listes de territoires à risques.
Le développement de l’épidémie en Italie amène à un changement de paradigme dans la gestion de la crise sanitaire. L’épidémie est dès lors considérée comme effectivement mondiale mais surtout elle est désormais perçue comme incontrôlable tant les foyers de contamination potentiels sont nombreux.
La densité des relations intra-européennes et l’intensité des mobilités extra-européennes génèrent un sentiment d’anxiété face au risque de la submersion, le concept de « vague » est constamment mobilisé. Certains y ont lu une inversion de l’ordre migratoire planétaire. Les pays aux revenus faibles ou limités décident de fermer leurs frontières aux individus issus des pays aux plus hauts revenus.
Les derniers jours du mois de février voient des gouvernements comme le Liban créer des listes de nationalités indésirables, tandis que d’autres comme Fiji décident d’un seuil de cas identifiés de Covid-19. Les interdictions progressent avec le Qatar et l’Arabie Saoudite qui ferment leur territoire aux Européens dès le 9 mars avant de connaître une accélération le 10 mars.
Les frontières sont alors emportées dans le tourbillon des fermetures.
La Slovénie débute la suspension de la libre circulation au sein de l’espace Schengen en fermant sa frontière avec l’Italie. Elle est suivie par les pays d’Europe centrale (Tchéquie, Slovaquie). En Afrique et en Amérique, les relations avec l’Union européenne sont suspendues unilatéralement. Le Maroc ferme ses frontières avec l’Espagne dès le 12 mars. Ce même jour, les États-Unis annonce la restriction de l’accès à son territoire aux voyageurs issu de l’Union européenne. La décision américaine est rapidement élargie au monde entier, faisant apparaitre l’Union européenne au cœur des mobilités planétaires.
En quelques jours, la majorité des frontières nationales se ferment à l’ensemble du monde. Les liaisons aériennes sont suspendues, les frontières terrestres sont closes pour éviter les stratégies de contournements.
Les pays qui échappent à cette logique apparaissent comme très minoritaires à l’image du Mexique, du Nicaragua, du Laos, du Cambodge ou de la Corée du Sud. Parmi eux, certains sont finalement totalement dépendants de leurs voisins comme le Laos et le Cambodge prisonniers des politiques restrictives du Vietnam et de la Thaïlande.
Au-delà de ces gouvernements qui résistent à la pression, des réalités localisées renseignent sur l’impossible fermeture des frontières aux mobilités quotidiennes. Ainsi, malgré des discours de fermeté, exception faite de la Malaisie, des États ont maintenus la circulation des travailleurs transfrontaliers.
Au sein de l’espace Schengen, la Slovénie maintient ses relations avec l’Autriche, malgré sa fermeté vis-à-vis de l’Italie. Le 16 mars, la Suisse garantit l’accès à son territoire aux salariés du Nord de l’Italie et du Grand Est de la France, pourtant les plus régions touchées par la pandémie en Europe. Allemagne, Belgique, Norvège, Finlande, Espagne font de même.
De l’autre côté de l’Atlantique, malgré la multiplication des discours autoritaires, un accord est trouvé le 18 mars avec le Canada et surtout le 20 mars avec le Mexique pour maintenir la circulation des travailleurs. Des déclarations conjointes sont publiées le 21 mars. Partout, la question transfrontalière oblige au bilatéralisme. Uruguay et Brésil renoncent finalement à fermer leur frontière commune tant les habitants ont développé un « mode de vie binational » pour reprendre les termes de deux gouvernements. La décision unilatérale du 18 mars prise par la Malaisie d’interdire à partir du 20 mars tout franchissement de sa frontière prend Singapour de court qui doit organiser des modalités d’hébergement pour plusieurs dizaines de milliers de travailleurs considérés comme indispensables.
Ces fermetures font apparaitre au grand jour la qualité des coopérations bilatérales.
Certains États ferment d’autant plus facilement leur frontière avec un pays lorsque préexistent d’importantes rivalités à l’image de la Papouasie Nouvelle Guinée qui ferme immédiatement sa frontière avec l’Indonésie pourtant très faiblement touchée par la pandémie. D’autres en revanche, comme la Tanzanie refusent de fermer leurs frontières terrestres pour maintenir aux États voisins un accès direct à la mer.
Certains observateurs se sont plu à imaginer des basculements dans les rapports de pouvoirs entre l’Afrique et l’Europe notamment. Après ces fermetures soudaines, le bal mondial des rapatriements a commencé, non sans de nombreuses fausses notes.
L’accélération de la frontiérisation du monde
La fermeture extrêmement rapide des frontières mondiales nous rappelle ensuite combien les dispositifs nationaux étaient prêts pour la suspension complète des circulations. Comme dans bien des domaines, la pandémie s’est présentée comme un révélateur puissant, grossissant les traits d’un monde qu’il est plus aisé de diagnostiquer, à présent qu’il est suspendu.
Ces dernières années, l’augmentation des mobilités internationales par le trafic aérien s’est accompagnée de dispositifs de filtrage de plus en plus drastiques notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les multiples étapes de contrôle articulant dispositifs administratifs dématérialisés pour les visas et dispositifs de plus en plus intrusifs de contrôle physique ont doté les frontières aéroportuaires d’une épaisseur croissante, partageant l’humanité en deux catégories : les mobiles et les astreints à résidence.
En parallèle, les routes terrestres et maritimes internationales sont restées actives et se sont même réinventées dans le cadre des mobilités dites illégales. Or là encore, l’obsession du contrôle a favorisé un étalement de la frontière par la création de multiples marches frontalières faisant de pays entiers des lieux de surveillance et d’assignation à résidence avec un investissement continu dans les dispositifs sécuritaires.
L’épaisseur des frontières se mesure désormais par la hauteur des murs mais aussi par l’exploitation des obstacles géophysiques : les fleuves, les cols, les déserts et les mers, où circulent armées et agences frontalières. À cela s’est ajouté le pistage et la surveillance digitale doublés d’un appareil administratif aux démarches labyrinthiques faites pour ne jamais aboutir.
Pour décrire ce phénomène, Achille Mbembe parlait de « frontiérisation du monde » et de la mise en place d’un « nouveau régime sécuritaire mondial où le droit des ressortissants étrangers de franchir les frontières d’un autre pays et d’entrer sur son territoire devient de plus en plus procédural et peut être suspendu ou révoqué à tout instant et sous n’importe quel prétexte. »
La passion contemporaine pour les murs relève de l’iconographie territoriale qui permet d’appuyer les représentations sociales d’un contrôle parfait des circulations humaines, et ce alors que les frontières n’ont jamais été aussi polymorphes.
Suite à la pandémie, la plupart des gouvernements ont pu mobiliser sans difficulté l’ingénierie et l’imaginaire frontaliers, en s’appuyant d’abord sur les compagnies aériennes pour fermer leur pays et suspendre les voyages, puis en fermant les aéroports avant de bloquer les frontières terrestres.
Les réalités frontalières sont rendues visibles : la Norvège fait appel aux réservistes et retraités pour assurer une présence à sa frontière avec la Suède et la Finlande. Seuls les pays effondrés, en guerre, ne ferment pas leurs frontières comme au sud de la Libye où circulent armes et combattants.
Beaucoup entretiennent des fictions géographiques décrétant des frontières fermées sans avoir les moyens de les surveiller comme la France en Guyane ou à Mayotte. Plus que jamais, les frontières sont devenues un rapport de pouvoir réel venant attester des dépendances économiques, notamment à travers la question migratoire, mais aussi symboliques, dans le principe de la souveraineté et son autre, à travers la figure de l’étranger. Classe politique et opinion publique adhèrent largement à une vision segmentée du monde.
Le piège de l’assignation à résidence
Aujourd’hui, cet appareil frontalier mondial activé localement, à qui l’on a demandé de jouer une nouvelle partition sanitaire, semble pris à son propre piège. Sa vocation même qui consistait à décider qui peut se déplacer, où et dans quelles conditions, semble égarée tant les restrictions sont devenues, en quelques jours, absolues.
Le régime universel d’assignation à résidence dans lequel le monde est plongé n’est pas tant le résultat d’une décision d’ordre sanitaire face à une maladie inconnue, que la simple activation des dispositifs multiples qui préexistaient à cette maladie. En l’absence d’autres réponses disponibles, ces fermetures se sont imposées. L’humanité a fait ce qu’elle savait faire de mieux en ce début du XXIe siècle, sinon la seule chose qu’elle savait faire collectivement sans concertation préalable, fermer le monde.
L’activation de la frontière a abouti à sa consécration. Les dispositifs n’ont pas seulement été activés, ils ont été renforcés et généralisés. Le constat d’une entrave des mobilités est désormais valable pour tous, et la circulation est devenue impossible, de fait, comme de droit. Pauvres et riches, touristes et hommes d’affaires, sportifs ou diplomates, tout le monde, sans exception aucune, fait l’expérience de la fermeture et de cette condition dans laquelle le monde est plongé.
Seuls les rapatriés, nouveau statut des mobilités en temps de pandémie, sont encore autorisés à rentrer chez eux, dans les limites des moyens financiers des États qu’ils souhaitent rejoindre. Cette entrave à la circulation est d’ailleurs valable pour ceux qui la décident. Elle est aussi pour ceux qui l’analysent : le témoin de ce phénomène n’existe pas ou plus, lui-même pris, complice ou victime, de cet emballement de la frontiérisation.
C’est bien là une caractéristique centrale du processus en cours, il n’y a plus de point de vue en surplomb, il n’y a plus d’extérieur, plus d’étranger, plus de pensée du dehors. La pensée est elle-même confinée. Face à la mobilisation et l’emballement d’une gouvernementalité de la mobilité fondée sur l’entrave, l’abolition pure et simple du droit de circuler, du droit d’être étranger, du droit de franchir les frontières d’un autre pays et d’entrer sur son territoire n’est plus une simple fiction.
Les dispositifs de veille de ces droits, bien que mis à nus, ne semblent plus contrôlables et c’est en ce sens que l’on peut douter de la réversibilité de ces processus de fermeture.
Réversibilité
C’est à l’aune de ce constat selon lequel le processus de frontiérisation du monde était à déjà l’œuvre au moment de l’irruption épidémique que l’on peut interroger le caractère provisoire de la fermeture des frontières opérée au cours du mois de mars 2020.
Pourquoi un processus déjà enclenché ferait machine arrière au moment même où il accélère ? Comme si l’accélération était une condition du renversement. Tout se passe plutôt comme si le processus de frontiérisation s’était cristallisé.
La circulation internationale des marchandises, maintenue au pic même de la crise sanitaire, n’a pas seulement permis l’approvisionnement des populations, elle a également rappelé que, contrairement à ce que défendent les théories libérales, le modèle économique mondial fonctionne sur l’axiome suivant : les biens circulent de plus en plus indépendamment des individus.
Nous venons bien de faire l’épreuve du caractère superflu de la circulation des hommes et des femmes, aussi longtemps que les marchandises, elles, circulent. Combien de personnes bloquées de l’autre côté d’une frontière, dans l’impossibilité de la traverser, quand le moindre colis ou autre produit traverse ?
Le réseau numérique mondial a lui aussi démontré qu’il était largement à même de pallier à une immobilité généralisée. Pas de pannes de l’Internet à l’horizon, à l’heure où tout le monde est venu y puiser son travail, ses informations, ses loisirs et ses sentiments.
De là à penser que les flux de data peuvent remplacer les flux migratoires, il n’y qu’un pas que certains ont déjà franchi. La pandémie a vite fait de devenir l’alliée des adeptes de l’inimitié entre les nations, des partisans de destins et de développement séparés, des projets d’autarcie et de démobilité.
Alors que le virus nous a rappelé la condition de commune humanité, les frontières interdisent plus que jamais de penser les conditions du cosmopolitisme, d’une société comme un long tissu vivant sans couture à même de faire face aux aléas, aux zoonoses émergentes, au réchauffement climatique, aux menaces à même d’hypothéquer le futur.
La réponse frontalière n’a ouvert aucun horizon nouveau, sinon celui du repli sur des communautés locales, plus petites encore, formant autant de petites hétérotopies localisées. Si les étrangers que nous sommes ou que nous connaissons se sont inquiétés ces dernières semaines de la possibilité d’un retour au pays, le drame qui se jouait aussi, et qui continue de se jouer, c’est bien l’impossibilité d’un aller.