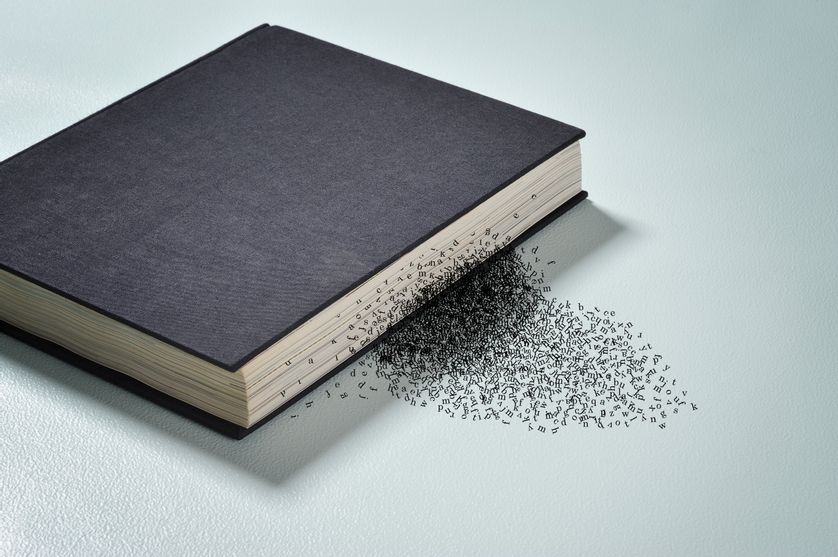Entre mai et août 2020 j’ai lancé sur le compte Twitter d’AgriGenre une série de sondages afin de comparer (i) les résultats que pouvaient m’offrir ces type de sondages – tout en ayant conscience des limites de cet outil – (ii) aux tendances de certaines problématiques de genre que je rencontrais sur le terrain dans les mondes agricoles.
La population qui a voté aux sondages d’AgriGenre sur Twitter peut être classée en :
Population agricole : sur Twitter les agriculteurs sont surreprésentés par rapport aux agricultrices. On a tendance à les retrouver plus fréquemment comme producteurs de tweets, de commentaires, de votes.
Population non agricole : composée de citoyen.ne.s, de militant.e.s, d’universitaires, de chercheur.euse.s, etc. Les réponses à certaines questions ont plutôt un caractère général et distancié. Il n’y a pas forcément de connaissance directe ni d’expérience concrète avec les mondes agricoles.
Les sondages de Twitter ne permettant pas de distinguer les différentes populations (agricole, non agricole) ni le genre des votants, j’ai souhaité comparer les précédents résultats, (i) votes des sondages Twitter et (ii) tendances de terrain, aux (iii) votes d’une troisième population composée uniquement d’agriculteurs et d’agricultrices, avec un large spectre géographique.
A l’aide de contacts dans le monde agricole, une population de cent cinquante agricultrices et agriculteurs a accepté de répondre à l’ensemble des questions posées préalablement sur le compte Twitter d’AgriGenre. Afin de ne pas influencer les votes, aucun lien n’a été indiqué entre ce nouveau sondage et les précédents.
Composition de l’échantillon :
Effectif : 150
Population : chef.fe.s d’exploitation agricole et coexploitant.e.s
Proportion : 53,3 % de femmes et 46,7 % d’hommes
Âge : entre 30 ans et 65 ans
Zone géographique : France métropolitaine
Types de production : maraîchage, arboriculture, grande culture, viticulture, élevage, apiculture
Syndiqué.e.s : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, Jeunes Agriculteurs, Mouvement de Défense des Exploitants Familiaux, Coordination Rurale, Confédération Paysanne
Non syndiqué.e.s
J’ai pu croiser (i) les résultats des sondages hybrides de Twitter avec (ii) les résultats que je recueillais directement sur le terrain et (iii) les résultats du sondage spécifique des agricultrices et agriculteurs de France métropolitaine.
I. L’agriculteur n’est pas l’agricultrice
A la question :
« Quand vous entendez ou lisez le mot agriculteur, vous pensez à :
– Un homme
– Un homme ou une femme
– Un homme et une femme
– Une femme »
Le sondage issu de Twitter (AgriGenre, août 2020, 580 votes) indique que l’on pense d’abord à un homme à 75,7 %, à un homme ou une femme à 18,6 %, à un homme et une femme à 5,3 %, à une femme à 0,3 %
Le mot agriculteur désignerait :
dans une version exclusiviste, un homme à 75,7 %, une femme à 0,3 %
dans une version relativiste, quelquefois un homme ou une femme à 18,6 %
dans une version universaliste, indistinctement un homme et une femme à 5,3 %
Le sondage issu du milieu agricole indique que l’on pense d’abord à un homme à 56,7 %, à un homme ou une femme à 37,2 %, à un homme et une femme à 10,7 % et à une femme à 0 %
Le mot agriculteur désignerait :
dans une version exclusiviste, un homme à 56,7 %, une femme à 0 %
dans une version relativiste, quelquefois un homme ou une femme à 37,2 %
dans une version universaliste, indistinctement un homme et une femme à 10,7 %
Les deux sondages font ressortir un accord d’ensemble.
Ces deux sondages font également ressortir que :
Le mot « agriculteur » représente strictement un homme entre 56,7 % et 75,7 % et il représente strictement une femme entre 0 % et 0,3 %.
Le mot « agriculteur » intègre le fait d’être parfois une femme entre 18,6 % et 37,2 % .
Le mot « agriculteur » intègre le fait d’être une femme entre 5,3 % à 10,7 %
Le mot « agriculteur » ne représente :
Ni « un homme et/ou une femme » (entre 5,3 % et 37,2 %)
Ni une « femme » (entre 0 % et 0,3 %)
Mais il représente bien un « homme » (entre 56,7 % et 75,7 %).
La femme agricultrice reste majoritairement invisible quand il est question du mot « agriculteur » à l’oral ou à l’écrit.
Parmi les femmes agricultrices :
63,75 % pensent à un homme quand elles lisent ou entendent le mot « agriculteur »
25 % pensent à un homme ou une femme
11, 25 % pensent à un homme et une femme
0% pensent à une femme
Parmi les hommes agriculteurs :
48,57 % pensent à un homme quand ils lisent ou entendent le mot « agriculteur »
41,43 % pensent à un homme ou une femme
10 % pensent à un homme et une femme
0 % pensent à une femme
Le mot « agriculteur » représente majoritairement un homme à la fois pour les femmes agricultrices et les hommes agriculteurs (entre 48,57 % et 63,75 %) qui s’entendent sur le fait que ce mot ne représente pas une femme (0 %), quelquefois un homme ou une femme (entre 25% et 41,43 %), et très peu un homme et une femme (entre 10 % et 11,25 %).
Il reste pour la femme agricultrice l’usage du mot « agricultrice », rentrée dans le dictionnaire Larousse en 1961.
Pour une agricultrice, la distinction entre agriculteur et agricultrice est bien marquée : « Agriculteur : nom masculin, personne qui cultive la terre. Agricultrice : nom féminin, personne qui s’occupe des enfants, de la maison, des courses, des repas, de la traite, des veaux, de la comptabilité et l’administratif de l exploitation. N’en jetez plus ! » (Josianne).
Une autre agricultrice s’empara également de son expérience pour résumer la chose de la manière suivante : « Dans l’esprit des gens, le mot agriculteur définit bien un homme. Dans le mien, j’ai la même côte, les mêmes bottes et les mêmes charges à payer, il ne me définit pas et le mot agricultrice n’est pas utilisé suffisamment et à sa juste valeur » (Laurence).
Ce qui est vaut pour les mots « agriculteur » et « agricultrice » vaut aussi pour les mots « paysan » et « paysanne ».
Dans un autre sondage issu de Twitter (AgriGenre, juin 2020 (A), 1 417 votes) portant sur la question « Faites-vous une différence entre agriculteur/agricultrice et paysan/paysanne ? » , 63,5 % ne font pas de différence contre 36,5 %.
Le retour du sondage issu des agricultrices et agriculteur va dans le même sens, 58,7 % ne font pas de différence contre 41,3 %.
Les deux sondages font ressortir un accord d’ensemble (entre 58,7 % et 63,5 %).
Parmi les femmes agricultrices :
52,5 % ne font pas de différence contre 47,5 %
Parmi les hommes agriculteurs :
65,7 % ne font pas de différence contre 34,3 %
Parmi les multiples témoignages, un type d’argument tend à revenir fréquemment : « Paysan ou agriculteur, qu’importe, Mais surtout pas « exploitant agricole ». Je considère que je n’exploite rien ni personne » (Gilles).
Plus critique, une femme agricultrice explique que « Certains veulent avoir à faire à des paysans ( du genre authentiques) alors que ce mot a été et l’est encore péjoratif . Paysan c’est une condition dont celle de femmes pour qui c’est pas jojo , alors que agriculteur, agricultrice c’est un métier avec des connaissances technique » (Clémentine).
Pour une autre femme agricultrice, « Le nom agricultrice a été donnée plus récemment avec la technicité et la modernisation de l’agriculture. Pour moi, paysanne contient le mot pays. Selon le contexte, les deux sont à employer et ont la même valeur à mes yeux » (Laurence).
Si ne pas nommer c’est ne pas faire exister, alors le mot « agriculteur » ne représente pas la femme, mais seul le mot « agricultrice », écrit ou parlé, représente bien une femme agricultrice, comme le mot « paysanne », écrit ou parlé, représente la femme paysanne.
II. Le difficile remplacement de l’agricultrice par l’agriculteur
En 1982, l’agricultrice Anne-Marie Crolais publiait un ouvrage témoignage où l’on pouvait lire qu’ « en agriculture, il est souvent plus facile de remplacer l’homme car pour remplacer l’agricultrice il faut à la fois travailler sur l’exploitation et remplir le rôle de femme d’intérieur et de mère de famille ». Le sondage demandait si le constat de 1982 était encore d’actualité en 2020 ?
Les résultats du sondage Twitter (AgriGenre, juillet 2020 (B), 164 votes) indiquent que les votants sont d’accord à 82,3 % (Tout à fait d’accord : 56,7% ; Plutôt d’accord : 25,6%) et pas d’accord à 17,7% (Pas vraiment d’accord : 12,8% ; Pas du tout d’accord : 4,9 %).
Les résultats du sondage issu du monde agricole indiquent être à d’accord à 54 % (Tout à fait d’accord : 19,3 % ; Plutôt d’accord : 34,7%) contre à 46 % (Pas vraiment d’accord : 30 % ; Pas du tout d’accord : 16 %).
Les deux sondages font ressortir un accord d’ensemble (entre 54 % et 82,3 %).
Parmi les femmes agricultrices :
28,75 % sont tout à fait d’accord, 38,75 % sont plutôt d’accord, 26,25 % ne sont pas vraiment d’accord et 6,25 % ne sont pas du tout d’accord.
Parmi les hommes agriculteurs :
8,57 % sont tout à fait d’accord, 30% sont plutôt d’accord, 34,29 % ne sont pas vraiment d’accord et 27,14 % ne sont pas du tout d’accord.
L’opposition entre les femmes agricultrices et les hommes agriculteurs est marquée :
67,5 % d’accord pour les agricultrices vs 61,43 % pas d’accord pour les agriculteurs.
J’ai pu constater sur le terrain que ce sujet restait sensible. Il pouvait être balayé d’un revers de manche, principalement par des agriculteurs, comme susciter un certain malaise chez des agricultrices. Sur ce point une agricultrice m’exprima le fait qu’elle se voyait dans l’exploitation familiale un peu comme « un couteau Suisse » (Marie).
Les questions liées à la place des femmes dans les exploitations agricoles, à leur pleine reconnaissance et considération, comme les questions portant sur la répartition sexuée des tâches restent toujours d’actualité, trente-huit après le témoignage d’Anne-Marie Crolais.
III. Des syndicats agricoles en peine avec les agricultrices
A la question : « Pensez-vous que les questions liées au partage des tâches domestiques, à la pénibilité au travail, aux inégalités de salaire… qui touchent les agricultrices sont suffisamment prises en compte par l’ensemble des syndicats agricoles ? », les résultats sortis de Twitter (AgriGenre, juillet 2020 (A), 63 votes) étaient sans appel : négatif pour 85,8 % des votants (Pas vraiment d’accord : 42,9% ; Pas du tout d’accord : 42,9%) contre 14,3% (Tout à fait d’accord : 9,5% ; Plutôt d’accord : 4,8%).
Le sondage issu du monde agricole donne un résultat proche : négatif pour 75,7 % des votants (Pas vraiment d’accord : 45,3 % ; Pas du tout d’accord : 30,4%) contre 24,3 % (Tout à fait d’accord : 3, 4 % ; Plutôt d’accord : 20,9 %).
Les deux sondages font ressortir un accord d’ensemble (entre 75,7 % et 85,8 %).
Parmi les femmes agricultrices :
1,25 % sont tout à fait d’accord, 12,5 % sont plutôt d’accord, 48,75 % ne sont pas vraiment d’accord et 37,5 % ne sont pas du tout d’accord
Parmi les hommes agriculteurs :
5,71 % sont tout à fait d’accord, 30 % sont plutôt d’accord, 42,86 % ne sont pas vraiment d’accord et 21,43 % ne sont pas du tout d’accord
Les femmes agricultrices considèrent à 86,25 % que les questions liées au partage des tâches domestiques, à la pénibilité au travail, aux inégalités de salaire… qui touchent les agricultrices ne sont pas suffisamment prisent en compte par les syndicats agricoles. Les hommes agriculteurs les rejoignent à 64,29 %.
Ces résultats marquent un échec de l’action des syndicats agricoles, toutes tendances confondues, face aux conditions des agricultrices. Ces résultats concentrent toute une série de problèmes, comme ceux évoqués ci-dessus : l’invisibilisation des agricultrices facilite la moindre attention des problèmes que subissent spécifiquement des agricultrices au sein des exploitations agricoles.
Cette situation n’a pas laissé indifférent des agricultrices : « Malheureusement ce n’est pas un sujet qui est majeur à leurs yeux. Pourtant ce sont des questions primordiales pour la vie des agricultrices » (Laurence), « Effectivement c’est un sujet qu’aucun syndicat ne traite à part entière, c’est vraiment navrant » (Clémence).
J’ai souligné dans un précédent article le côté masculin marqué des mondes agricoles, tant au niveau syndical que ministériel :
Au niveau syndical, entre 1946 et 2020, sur cinquante deux représentants nationaux, cinquante ont été des hommes et seulement deux des femmes (50 vs 2).
Au niveau ministériel, entre 1836 et 2020, sur un effectif de cent quarante cinq ministres ou secrétaires d’État à l’agriculture, cent quarante trois ont été des hommes et seulement deux des femmes (143 vs 2).
Une agricultrice me rapportait qu’elle regrettait qu’en 2020 les agricultrices soient encore considérées comme « une sorte de caution morale que l’on sort de temps en temps du placard pour se donner une bonne conscience dans une profession majoritairement masculine où les hommes monopolisent toujours les postes de représentation et de responsabilité » (Nathalie).
Si ne pas nommer c’est ne pas faire exister, ne pas être représenté.e c’est aussi ne pas faire exister.
IV. Des espaces non-mixtes en question
La question posée sur Twitter était la suivante : « Depuis de nombreuses années des agricultrices se réunissent en groupes et espaces non-mixtes. Comprenez-vous que ce choix persiste de nos jours ? ».
Les votants de Twitter (AgriGenre, juin 2020 (B), 796 votes) ont répondu à 83,5% oui et 16,5% non.
Or sur le terrain les positions que je rencontrai – sans distinction de genre , d’âge ou de position politique/syndicale – n’étaient pas aussi tranchées (pratiquement autant d’avis positifs que négatifs). Je n’ai pas observé un raz-de-marée aussi flagrant d’avis positifs (sauf à penser que mes échantillons et mes terrains étaient systématiquement biaisés).
Les votants du sondage issu du monde agricole ont répondu à 61,5 % oui et 38,5 % non, ce qui me semble plus près de la réalité de terrain.
Les deux sondages font ressortir un accord d’ensemble (entre 61,5 % et 83,5 %).
Parmi les femmes agricultrices :
62,5 % comprennent ce choix contre 37,5 %
Parmi les hommes agriculteurs :
58,57 % comprennent ce choix contre 41,43 %
Cette question des espaces non-mixtes fait toujours l’objet de débat au sein des mondes agricoles.
Pour certaines agricultrices la non-mixité de réunion « est une porte ouverte à la ségrégation » (Marie).
Dans le camps des opposé.e.s à ce type de réunion, je rencontre plus couramment des agricultrices qui mettent en avant leur fort caractère et leur volonté de ne pas se laisser faire : « Je comprends pas du tout ce genre de comportement moi. Qu’il y ait des hommes ou des femmes ma parole est libre et franche et sans entraves. De toute façon, et tant pis pour les réflexions et les regards, je m’exprime de toute façon et je tacle si besoin ! » (Clémence).
D’autres enfin sont plutôt favorables à la mixité mais elles comprennent ce besoin temporaire en #non-mixité : « Pour avoir animé des formations en groupe mixte ou non, je trouve que la mixité est très enrichissante pour les participants. Mais certaines personnes préfèrent les groupes non mixtes où leur parole sera plus libérée » (Charlotte).
Chez les agriculteurs et agricultrices totalement acquis à la non-mixité, celle-ci est légitimée par l’expérience au sein du monde agricole :
« Pour avoir fait une partie de mes études en lycée agricole, j’ai pu malheureusement constater que le sexisme est très (très) présent, et les femmes très minoritaires, donc je comprends qu’elle ai besoins de se retrouver ensemble pour lutter contre cette discrimination » (Nicolas).
« La non mixité permet de libérer la parole donc par moments elle est indispensable » (Philomène).
« La « mecterruption » et la « mecxplication » sont manifestes, comme la misogynie en général. On peut comprendre le besoin de certaines femmes de vouloir se retrouver entre-elles. On ne se pose d’ailleurs pas la question quand un groupe est uniquement composé d’hommes. Du reste, les réunions féminines non-mixtes n’empêchent pas leurs participantes d’assister à des réunions mixtes en parallèle » (Stéphanie).
V. Un matériel agricole encore trop peu adapté aux femmes agricultrices
A la question « Pensez-vous que le matériel agricole (outil, machine) utilisé par les agriculteurs/agricultrices doit tenir compte du genre ou être indifférent au genre ? »
Les résultats issus de Twitter (AgriGenre, mai 2020, 125 votes) indiquent un vote majoritaire à 78,8% pour l’indifférence au genre contre 27,2% qui demandent à tenir compte du genre.
Les résultats issus du monde agricoles indiquent que 45,3 % souhaitent une indifférence au genre et 54,7 % souhaitent tenir compte du genre.
Les deux sondages font ressortir un désaccord d’ensemble.
Parmi les femmes agricultrices :
75 % pensent que le matériel agricole doit tenir compte du genre contre 25 %
Parmi les hommes agriculteurs :
68,57 % pensent le matériel agricole ne doit pas tenir compte du genre contre 31,43 %
Des femmes agricultrices voient des problèmes de force, de poids, de taille… là où des hommes agriculteurs semblent les ignorer.
Mes retours de terrain indiquent que la population agricole féminine interrogée fait pencher la balance du côté de la prise en compte du genre dans l’usage des outils et machines agricoles.
Encore de nos jours, pour certains agriculteurs ou personnes du monde agricole, la profession reste un domaine réservé, masculin et viril, où la femme n’est pas toujours bien acceptée comme agricultrice, ou alors à côté de l’homme, comme une aide complémentaire, une sorte de side-farmer.
Une agricultrice m’expliquait récemment toutes les difficultés qu’elle avait dû rencontrer « lors de formations sur certains aspects techniques et tout particulièrement lors des formations avec l’utilisation des machines » (Isabelle) . Elle s’était heurtée à « l’impossibilité d’accéder aux outils » et « si la formatrice faisait en sorte que les femmes aient le même temps que les garçons » une crise s’en suivait. A quoi se rajoutait le fait qu’elle n’arrivait pas à avoir un « accès égal et de loin » aux machines comme les tracteurs, les tronçonneuses, les pelleteuses…
Que retenir ?
Le mot « agriculteur » ne représente pas les femme agricultrices.
Pour des femmes agricultrices interrogées, il est plus facile de remplacer un homme agriculteur qu’une femme agricultrice sur une exploitation agricole. Ce que contestent des hommes agriculteurs interrogés.
Pour des hommes agriculteurs et des femmes agricultrices interrogé.e.s, les syndicats agricoles ne prennent pas en compte les questions liées au partage des tâches domestiques, à la pénibilité au travail, aux inégalités de salaire… qui touchent des femmes agricultrices.
Pour des hommes agriculteurs et des femmes agricultrices interrogé.e.s, les espaces en non-mixité sont légitimes.
Pour des femmes agricultrices interrogées, il est justifié de tenir compte du genre quand il est question du matériel agricole. Ce que contestent des hommes agriculteurs interrogés.
Si des hommes agriculteurs interrogés ne sont pas insensibles à certains problèmes que rencontrent des femmes agricultrices (points 3 et 4) une partie de leurs positions rentre en contradiction avec ce qu’expriment des femmes agricultrices (points 2 et 5). Pourrait-on émettre l’hypothèse qu’une égalité idéalisée tendrait à se substituer à une inégalité réelle dans les mondes agricoles entre les hommes et les femmes ?
Alors, comment être une agricultrice en 2020 dans ces conditions ?