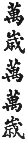Pour le philosophe Serge Audier, la gauche n’est pas très écolo - Idées - Télérama.fr
►https://www.telerama.fr/idees/pour-le-philosophe-serge-audier,-la-gauche-nest-pas-tres-ecolo,n6141758.php
Dans “L’âge productiviste”, le philosophe Serge Audier montre que la gauche, pourtant porteuse d’un projet alternatif au capitalisme, ne s’est pas souciée d’écologie. Parce qu’elle est depuis toujours fascinée par le productivisme.
L’écologie, ses occasions perdues, ses virages manqués… En dépit de quelques éclairs de lucidité de penseurs politiques pour la plupart oubliés, le culte de la production et de la croissance industrielle a toujours pris le dessus sur le souci écologique, y compris dans le camp progressiste. La gauche, notamment, en intériorisant l’apologie de l’industrialisme capitaliste, a montré son incapacité à inventer un imaginaire politique propre, opposé à ce productivisme. Dans L’Age productiviste, une nouvelle somme historique érudite qui prolonge La Société écologique et ses ennemis, le philosophe Serge Audier explore de fond en comble les logiciels anti-écologiques de la gauche et de la droite modernes, du début du xixe siècle à nos jours. Et dessine la généalogie d’une impuissance générale aujourd’hui dénoncée, mais favorisée par la résistance tenace d’un productivisme atavique.
En tant qu’historien des idées politiques, quelle approche spécifique défendez-vous sur le péril écologique ?
On parle généralement du péril écologique d’un point de vue scientifique, climatologique ou éthique ; on envisage des pratiques alternatives. La tendance dominante me semble manquer d’un questionnement politique et idéologique. J’ai voulu le réhabiliter pour comprendre les sources, toujours actives, de la crise écologique — à droite, bien sûr, mais aussi à gauche. Mon précédent livre, La Société écologique et ses ennemis, montrait que, dès le début du xixe siècle, bien des penseurs avaient vu la gravité des problèmes écologiques. Cette approche articulait déjà une critique à la fois sociale, écologique et même esthétique. Mais une hégémonie industrialiste et productiviste s’est imposée jusque dans le camp progressiste. Elle a pris le dessus sur le souci écologique. C’est au fond l’histoire d’une défaite politique et idéologique que je raconte : des voies alternatives ont existé, mais elles ont été piétinées et oubliées par le récit dominant.
La critique écologiste est longtemps restée indexée à une critique radicale de la modernité. Etait-ce le cas chez les précurseurs de l’écologie politique ?
La critique de l’industrialisme va effectivement souvent de pair avec un procès généralisé de la modernité, y compris du rationalisme et des droits de l’Homme. Mais toutes les figures conscientes de la crise écologique n’appartenaient pas à une nébuleuse anti-moderne, anti-Lumières ou anti-libérale. On trouve ainsi une grande sensibilité à la question chez le philosophe utilitariste et libéral John Stuart Mill, qui anticipe la problématique de la décroissance. La critique anti-industrielle a certes été portée par des courants conservateurs, mais aussi par des courants rationalistes héritiers des Lumières. Pensons à Franz Schrader, géographe qui opposait aux folies destructrices de l’âge industriel la préservation rationnelle des forêts vierges, ou encore à Edmond Perrier, pilier du Muséum d’histoire naturelle, qui prévoyait l’épuisement des ressources, lui aussi dès le début du xxe siècle. Les anarchistes, comme Elisée Reclus, développèrent également une critique écologique de l’industrialisme au nom de la liberté, mais aussi de la rationalité scientifique.
Comment comprendre l’incapacité de la gauche à prendre au sérieux le péril écologique, alors même qu’elle prétend favoriser le progrès ?
Etant porteuse d’une critique du capitalisme et d’un projet alternatif, la gauche aurait dû en effet prendre davantage en charge le péril écologique. Or elle l’a fait mal, peu ou pas du tout. Le culte des forces productives fut un facteur décisif. Si le communisme s’est montré si attrayant, c’est aussi parce qu’une large partie de la gauche avait intériorisé cet impératif de développement scientifique et industriel. Ce qui confirme d’ailleurs que le productivisme n’est pas intrinsèquement lié au « libéralisme ».
Pourquoi l’écologie politique est-elle toujours restée minoritaire dans le logiciel de la gauche socialiste ?
Le pôle écologique est presque partout resté dominé, même après la prise de conscience des années 1970. On ne peut l’expliquer seulement par certains travers du mouvement écologique. Il y a certes une tendance écologique dans la « deuxième gauche » des années 1970, mais dès que celle-ci se « normalise », au début des années 1980, cette orientation s’étiole. Même après l’effondrement du communisme, si fortement anti-écologique, persiste l’hégémonie des figures diverses du productivisme, depuis le productivisme souverainiste jusqu’à celui du centre-gauche « social-libéral » qui, épousant les mutations du capitalisme et de la mondialisation, a encore pour horizon la relance de la croissance. Tout cela me semble remonter à une fascination compréhensible pour la société industrielle, facteur de progrès, d’abondance et d’emploi. On peut la repérer même dans le socialisme originaire, divisé par des tendances contradictoires. Les milieux fouriéristes et anarchistes avaient certes esquissé une sorte de socialisme jardinier qui entendait se réconcilier avec la nature. Mais, à côté de ce socialisme naturaliste, s’imposait un autre pré-socialisme, venu du comte de Saint-Simon, fasciné par l’industrie, les ingénieurs et la science, qui a inventé le néologisme « industrialisme ». Le saint-simonisme a exercé une influence colossale dans l’histoire de la gauche, en posant que l’avenir du monde appartient aux industriels. On trouve là également une des sources aussi bien du marxisme dogmatique que du discours technocratique. L’imaginaire dominant de gauche a été « phagocité » par cette vision saint-simonienne, elle-même dominée par une apologie diffuse de l’industrialisme capitaliste. L’histoire de la gauche, même anticapitaliste — et même marxiste ! — a été marquée par une intériorisation de la nécessité historique du capitalisme industriel, et de l’apport grandiose de ce dernier, tout en le condamnant plus ou moins. A cet égard, cette histoire est aussi celle d’une impuissance à développer un imaginaire propre.
Quid de la tradition libérale et de l’histoire de la droite sur cette question ?
Le libéralisme en soi n’est pas de droite ou de gauche. Et, à partir du XIXe siècle, il ne célèbre pas toujours l’industrialisme — Tocqueville s’en méfiait. Reste que la tendance à cette célébration est majoritaire à droite depuis Benjamin Constant, qui construit un discours apologétique du progrès industriel, foyer de liberté et de prospérité. Et puis se constitue l’école d’économie politique, autour de figures comme Vilfredo Pareto, qui détestait les critiques écologiques et esthétiques du capitalisme. On retrouve cette tendance dans le néo-libéralisme contemporain.
Des « brèches » écologiques ont pourtant aussi existé à droite…
Une certaine critique, de droite et antilibérale, du capitalisme industriel, a pu revêtir une portée écologique jusqu’à nos jours. Cette tendance « verte » est présente dans la mouvance conservatrice réactionnaire, dans la « Révolution conservatrice » sous l’Allemagne de Weimar, voire dans le fascisme et le nazisme. Avant d’être avancée par le pape François, la formule de « l’écologie intégrale », qui relie la question écologique et la question sociale, fut lancée par Alain de Benoist, le père de la « Nouvelle Droite ». Le pôle conservateur a également développé dès les années 1930 une dénonciation du productivisme, du taylorisme et du fordisme, comblant le vide de la gauche. Le fait même que cette critique passe alors à droite contribue d’ailleurs à la décrédibiliser auprès des progressistes. Même le néolibéralisme fut clivé à l’origine, dans les années 1930 : une sensibilité à la destruction industrielle de la nature y existe, mais ce pôle, minoritaire, sera, toujours plus, dominé par un pôle anti-écologique et climato-sceptique.
Pourquoi la plupart des grands intellectuels du xxe siècle en France ont-ils négligé la question écologique ?
L’existentialisme et le structuralisme y furent indifférents. Sartre et Beauvoir sont des philosophes de la liberté du sujet. Ils refusent toute idée d’« essence » humaine et la nature n’est pas un principe explicatif ni un objet autonome dans leur pensée de la liberté. La seconde dira même que la nature est « de droite ». Si la vague structuraliste, et « post-structuraliste », déboulonna ensuite cette approche « humaniste », elle n’en resta pas moins largement aveugle, elle aussi, à la question de la nature. Michel Foucault n’y prêta aucune attention sérieuse, tant il se méfiait des discours « naturalisant » les institutions et les individus. Plus tard, son adversaire de toujours, Marcel Gauchet, couvrira de sarcasmes les écologistes. Il y eut bien sûr des exceptions, en particulier Claude Lévi-Strauss. Mais ce sont surtout des voix ultra minoritaires qui transmirent la flamme écologique. Ainsi de Jacques Ellul et Bernard Charbonneau, amoureux de la nature et critiques de la « méga-machine » technologique. Après une longue traversée du désert, ils ont influencé l’écologie politique naissante. André Gorz ou Serge Moscovici furent d’autres exceptions, soucieux de la manière dont le capitalisme appuyé par l’Etat privait les individus du contrôle de leur propre vie et de leur milieu vital.
Peut-on enfin envisager la possibilité d’une sortie de cet âge productiviste ?
Le capitalisme a muté. Mais la droite, comme l’extrême droite, entretient le credo de la croissance à tout prix et le déni de la crise écologique. Et, à gauche, on est dans un entre-deux indécis. Le populisme de gauche, incarné par Jean-Luc Mélenchon, se réclame d’un « éco-socialisme », mais l’ambiguïté demeure, car en privilégiant le thème du clivage entre le peuple et les élites, il tend à gommer l’urgence écologique. Une autre gauche, portée notamment par Benoît Hamon, a compris que le logiciel productiviste était une impasse ; elle cherche du côté de l’allocation universelle ou d’un modèle écologiquement soutenable, mais peine à construire un discours cohérent et à trouver une base sociale.
Le modèle « éco-républicaniste » que vous défendez peut-il nous sauver du péril écologique ?
Je parle moins de modèles que de rapprochements politiques possibles, entre le libéralisme, le conservatisme, l’anarchisme, le féminisme, le socialisme ou le républicanisme. La tradition républicaine telle que je la conçois est une philosophie de la vie civique, fondée sur une conception de l’homme comme citoyen plus que comme producteur et consommateur. Or la crise écologique est aussi liée à une crise civique, à une vision étriquée de la liberté, celle des entreprises et des consommateurs. Corrélativement, la tradition républicaine est hantée par l’impératif du bien commun et de l’intérêt général — d’où aussi sa philosophie du service public. Et l’intérêt général a une dimension intergénérationnelle, il se déploie dans l’horizon du temps. Cette exigence de solidarité entre les générations est au cœur de la philosophie républicaine comme de l’écologie politique. Elle ne se fera pas sans d’âpres luttes.