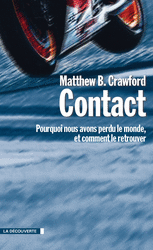Matthew Crawford est chercheur associé à l’université de Virginie, aux Etats-Unis. Après des études de physique, il se tourne vers la philosophie. Déçu par un premier emploi, il décide de se faire mécanicien. Matthew Crawford fonde Shockoe Moto, un atelier de réparation de motos. Il est également l’auteur de deux ouvrages largement remarqués : Contact (La Découverte, 2016) et Eloge du carburateur (La Découverte, 2010).
Vous avez vous-même fait l’expérience d’un changement de carrière, en quittant la direction d’un think tank pour ouvrir un atelier de réparation de motos. Pourquoi avez-vous changé de métier ?
Cet emploi dans un endroit consacré à la réflexion avait toutes les apparences d’un travail stimulant. C’était, il est vrai, un second choix. Jeune diplômé, j’espérais rejoindre une université, mais je n’ai rien trouvé. Lorsqu’un contact m’a indiqué que ce think tank cherchait un nouveau directeur exécutif, j’ai cru que ce poste était prometteur.
Mais dès les premières heures, j’ai compris qu’il n’offrait aucune liberté de pensée. Il fallait simplement atteler son esprit à formuler les meilleurs arguments possibles dans un certain débat, ce qui demande de réfléchir à partir d’une conclusion prédéterminée. Il faut donc imaginer les arguments et l’enchaînement logique pour arriver au résultat attendu, ce qui est un exercice intellectuel un peu vain. Je n’arrivais pas toujours à me convaincre moi-même. C’était démoralisant.
Comment avez-vous fait pour tenir ?
Je n’aimais pas ce travail, mais j’avais besoin d’argent. Je suis donc resté cinq mois. Et pendant tout ce temps, je rêvais de réparer des motos. Grâce à un ami, j’avais découvert les bases de ce métier au cours de mes études post-doctorales et je me demandais déjà s’il serait possible d’en vivre. Dans ce think tank, je passais donc une partie de mes journées à feuilleter des catalogues d’outils, en comptant combien de temps je devrais garder cet emploi avant de pouvoir me les payer.
Après cinq mois, j’avais rassemblé tout le matériel nécessaire. J’ai donc démissionné et je me suis mis à travailler sur des deux-roues. D’abord, dans mon garage, puis j’ai trouvé un peu plus grand. A vrai dire, j’avais très peu d’expérience, je connaissais mieux les voitures. J’ai donc appris sur le tas. Mais comparativement au boulot dans ce think tank, c’était génial. Avec une moto, on ne triche pas ; soit elle démarre, soit elle ne démarre pas.
Votre expérience vous a-t-elle amené à reconsidérer la valeur du travail intellectuel ?
Etablir un diagnostic mécanique pour une moto en panne puis la réparer constitue un travail très stimulant sur le plan intellectuel. Certaines idées préconçues nous poussent pourtant à croire le contraire. On continue d’accorder une plus grande valeur au travail intellectuel effectué dans un bureau, comme s’il était forcément plus intéressant, plus exigeant, alors qu’en fait, l’économie de la connaissance crée beaucoup de ces emplois sans intérêt, qui n’engagent en rien votre intelligence.
Entre le travail intellectuel et le travail manuel, une opposition factice existe toujours dans l’esprit de bien des gens et conduit à dévaluer le second. Si on se salit les mains, c’est que l’on fait un boulot idiot. Ce préjugé existe toujours.
Renverser ce préjugé demande d’établir une épistémologie du travail manuel. Quelles peuvent en être les bases ?
Martin Heidegger m’a aidé à dépasser ces préconceptions et à mieux comprendre mon expérience du travail. C’est bien connu, ce philosophe explique que notre façon de connaître un objet provient de notre interaction avec lui. On n’apprend pas ce qu’est un marteau en le contemplant mais en l’employant. Ce fut pour moi un point de départ pour réfléchir à ce que serait une connaissance incarnée.
Lorsque vous essayez de comprendre pourquoi une moto ne fonctionne pas, vous formulez différentes hypothèses sur l’origine de cette panne. Mais les causes peuvent interagir les unes avec les autres, ce qui rend les choses encore plus complexes. Vous lancez donc votre enquête sur la base de pressentiments plutôt que de règles. Ces intuitions sont le fruit de l’expérience. Le philosophe hongrois Michael Polanyi (1891-1976) fournit une définition de ce que pourrait être cette intuition lorsqu’il parle de connaissances personnelles, un type de connaissances acquis uniquement après avoir été longtemps en contact avec l’objet de ce savoir.
Vous dites que le travail manuel est dénigré par des clichés persistants. Mais ne le considère-t-on pas, à l’inverse, avec un peu trop de romantisme, comme s’il permettait d’échapper aux contraintes du monde moderne ?
Il y a en effet un grand appétit pour cette vision du travail manuel, que ce soit pour en vanter les prétendues vertus thérapeutiques, le réduire au mouvement, très populaire aux Etats-Unis du « faites-le vous-même » (« do it yourself »), ou pour l’assimiler à du développement personnel. Mais c’est avant tout la figure de l’artisan, dont certains intellectuels se sont saisis pour en développer une vision romantique, qu’il s’agisse du luthier ou du forgeron fabricant l’épée d’un samouraï. Je m’intéresse davantage aux plombiers et aux électriciens, des métiers dévalués mais qui permettent à ceux qui font le choix de cette carrière de bien vivre et de rencontrer chaque jour de nouveaux défis. En m’intéressant à ces métiers, j’ai voulu éviter toute esthétisation.
Ma principale préoccupation consiste à rappeler qu’il est essentiel de trouver un travail qui ne vous rende pas plus idiot que vous ne l’êtes. Tant d’emplois sont abrutissants ; un sommet est atteint avec la chaîne de montage. Mais l’environnement physique dans lequel travaillent un plombier, un électricien, un mécanicien varie trop d’une journée à l’autre pour que ces métiers puissent être réduits à l’exécution répétitive d’une procédure. Il faut savoir improviser et s’adapter. Et je crois que cela permet de se sentir davantage comme un être humain et moins comme le rouage d’une machine.
La vraie question n’est pas tant de savoir si vous travaillez avec vos mains ou dans un bureau, mais si vous exercez votre jugement au travail. Et c’est sur cette base que je crois qu’il faut renouveler notre regard sur les métiers manuels. Certes, ils ne sont pas pour tout le monde, mais trop souvent ils sont dévalués dès l’école et on rappelle trop peu les possibilités qu’ils offrent. Les enfants sont poussés à aller à l’université ; je crois qu’il est important de rappeler qu’il y a d’autres possibilités qui sont plus enrichissantes qu’on ne le dit. Il y a différentes voies d’accès à la connaissance ; s’asseoir en classe puis dans un bureau n’est pas la seule qui existe. Si vous êtes un garçon de 16 ans qui tente de construire une voiture de course, soudainement la trigonométrie va vous intéresser parce que vous en voyez l’utilité.
Ne craignez-vous pas de dénigrer le rationalisme à une époque où la science est attaquée de toutes parts ?
Non, je crois au contraire aider à rétablir l’importance de la science en l’inscrivant dans un contexte plus large. Travailler avec des choses physiques signifie que vous êtes constamment en contact avec les éléments de la nature. Si l’on parcourt l’histoire de l’innovation technologique, on se rend compte que très souvent des percées dans la recherche n’ont pas précédé des développements technologiques – elles en sont plutôt le fruit. Par exemple, le moteur à vapeur a été développé par des mécaniciens qui avaient observé la relation entre la température et la pression. Et c’est grâce à l’essor de ce moteur qu’une branche de la physique, la thermodynamique, est sortie de certaines impasses dans lesquelles elle se trouvait alors.
Aristote avait également observé que si l’on se coupe des choses se trouvant dans la nature, du monde physique, il devient facile de construire des dogmes sur la base de quelques observations. Les métiers manuels se caractérisent par leur déférence envers le monde réel et je crois que c’est un trait que partage la science. Quand vous dessinez un système de ventilation pour un immeuble ou quand vous essayez de comprendre pourquoi il est en panne dix ans plus tard, ce sont des tâches qui demandent d’engager son esprit et ses aptitudes intellectuelles.
Se rapprocher du monde matériel, comme vous le proposez, est largement une entreprise personnelle. Mais ce projet a-t-il une dimension politique ?
Je crois que mon message peut rapprocher des électorats qui s’opposent aujourd’hui, les classes moyennes supérieures et les classes populaires. Lorsque vous entreprenez de réparer vous-même votre frigo, très rapidement vous découvrez à quel point c’est difficile. C’est une véritable leçon d’humilité. La prochaine fois que vous ferez appel à un professionnel de ce métier, vous aurez alors davantage de choses en partage, vous pourrez mieux apprécier son travail.
Cette expérience, dans une période de profondes divisions comme aujourd’hui, est fondamentale sur le plan politique, parce qu’elle nous sort des enclaves réelles et virtuelles dans lesquelles nous vivons. Il est fort probable que ce professionnel habite dans la périphérie et qu’il se déplace dans la ville où résident ses clients. Cette ségrégation se traduit par l’érection de frontières politiques, parce que l’espace de partage entre classes sociales est en train de disparaître. Tenter de faire par soi-même ces petits travaux peut permettre de faire émerger un peu plus d’empathie entre des gens qui ne se ressemblent pas.