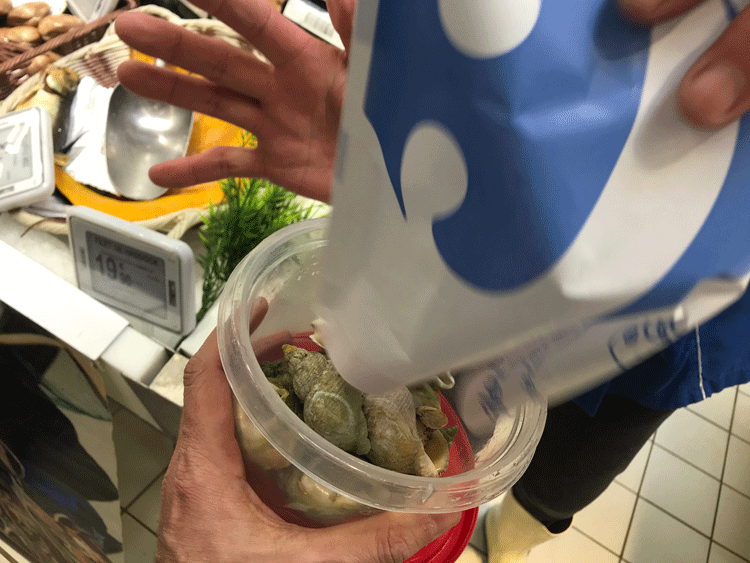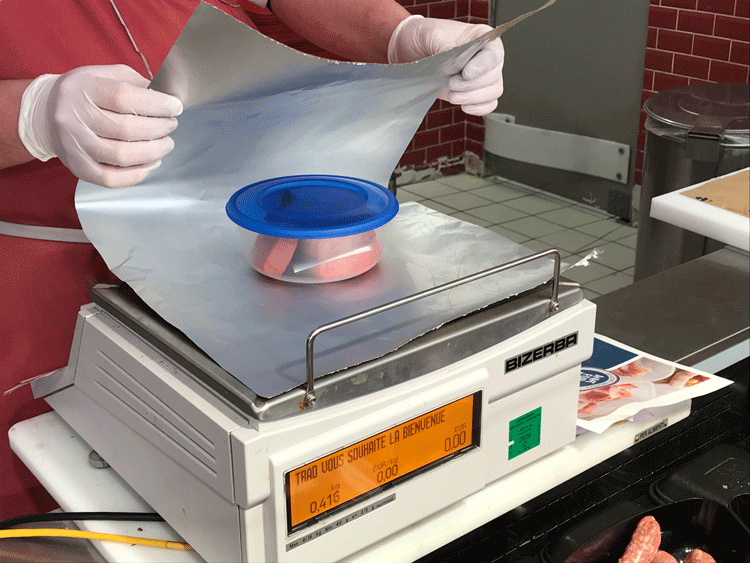Elue en juin, la jeune édile #EELV de #Poitiers, ancienne scoute, place les idéaux de #concertation, de #bienveillance et d’#exemplarité au cœur de sa #gouvernance.
Comment faut-il appeler Léonore #Moncond'huy ? Madame le maire, madame la maire, madame la mairesse ? Inévitable question dès lors qu’une femme prend les commandes d’une commune. La première intéressée l’a posée directement aux habitants de Poitiers. C’était une semaine avant le premier tour des municipales, le 8 mars, date de la Journée internationale des droits des femmes. Sondées par son équipe de campagne sur un marché du centre-ville et dans un quartier populaire, 430 personnes ont placé en tête « madame la maire . « C’était aussi ma préférence. Mais, si une autre appellation avait été choisie, je l’aurais tout aussi bien adoptée », confie la nouvelle élue.
L’anecdote paraîtrait anodine si elle ne témoignait pas de l’importance qu’accorde Léonore Moncond’huy à la démocratie locale, l’un des trois « piliers » de sa campagne victorieuse, avec l’écologie et la justice sociale. En battant le maire sortant Alain Claeys (Parti socialiste, PS), le 28 juin, la tête de liste Europe Ecologie-Les Verts (EELV) du projet Poitiers collectif a défié tous les pronostics, au sein même de sa famille politique. Le PS détenait la ville depuis 1977. Jamais Poitiers (88 000 habitants) n’avait été dirigé par une femme. Et jamais par quelqu’un d’aussi jeune : 30 ans.
Son score flatteur 42,83 % contre 35,60 % pour Alain Claeys et 21,56 % pour le candidat La République en marche (LRM), Anthony Brottier a jeté une lumière vive sur cette inconnue, simple conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. L’une de ses toutes premières mesures n’a fait qu’accentuer la curiosité à son égard : en décidant de baisser d’un tiers son indemnité de maire, ramenée à 3 500 euros net par mois afin de réduire l’écart avec les conseillers municipaux , Léonore Moncond’huy a vu son nom faire le tour du Web.
« Cela me plaisait d’envoyer un message de sobriété », raconte-t-elle ce matin-là, derrière la façade Second Empire de l’hôtel de ville. Un vitrail représentant Aliénor d’Aquitaine illumine le salon d’honneur, situé au même étage que son bureau. Dans un coin, un éventail de photos personnelles : n’y figurent ni parent, ni enfant, ni même de selfie avec une personnalité politique. Mais uniquement des clichés de l’équipe de campagne.
« Biberonnée à l’éducation populaire »
Sacrée campagne, au demeurant. Sa victoire, Léonore Moncond’huy la doit autant à un phénomène de dégagisme, qui a mis fin au règne d’Alain Claeys, en place depuis 2008, qu’à une stratégie électorale innovante, dont la matrice est l’éducation populaire. Scoute depuis l’âge de 11 ans chez les Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France, elle a gravi tous les échelons au sein de cette association protestante centenaire, de « louvette » à membre du conseil d’administration poste dont elle démissionnera d’ailleurs prochainement, tout comme de son mandat régional, afin de se consacrer pleinement à Poitiers.
« J’ai été biberonnée à l’éducation populaire, qui a davantage nourri mon parcours politique que ne l’a fait mon parcours académique », confie cette multidiplômée deux licences, deux masters qui travaillait jusqu’ici comme coordinatrice de projets dans un bureau d’études oeuvrant dans l’aide au développement. Créé par un petit groupe d’amis non encartés, à l’exception d’elle, Poitiers collectif s’est donné des airs de laboratoire politique, deux ans durant. Son credo : transposer à une campagne électorale des techniques empruntées aux mouvements de jeunesse.
Ont ainsi été mis en oeuvre toute une gamme d’ « outils d’intelligence partagée » - « gestion par consentement », « élection sans candidat », « communication bienveillante », « cercles de médiation » -, bien connus des responsables de MJC et de centres socioculturels. « L’idée était de casser les codes du passé afin de redonner confiance aux électeurs dans la politique », explique l’ex-directeur de campagne, Charles Reverchon-Billot, salarié d’une association d’éducation populaire et compagnon de Léonore Moncond’huy à la ville.
Déclinée à travers moult tables rondes, manifs à vélo et autres happenings, la méthode a bousculé les habitudes politiciennes, Poitiers collectif refusant par exemple de dénigrer les listes concurrentes, pour mieux communiquer sur son programme. « On nous a taxés de Bisounours », s’en désole encore Léonore Moncond’huy, elle-même nommée tête de liste à l’issue d’un processus très emblématique de cette nouvelle façon de faire.
Fin 2019, une réunion « houleuse » de cinq heures, passée notamment à remplir des fiches types sur le profil du candidat idéal, était alors arrivée à ses fins : coopter une ou un postulant qui n’avait pas eu le droit de s’autodéclarer préalablement. Une voix s’était levée, dans la nuit, pour proposer le nom de Léonore Moncond’huy, malgré son « double handicap » d’être adhérente à un parti (sacrilège !) et de posséder une expérience d’élue (bis). « Ce qui a plaidé, c’est que je sois jeune et femme, et très impliquée dans le mouvement », se rappelle l’impétrante malgré elle, pas mécontente cependant d’avoir été désignée.
L’esprit « sociocul » de la campagne plane aujourd’hui sur l’hôtel de ville, comme en témoignent les appellations des nouvelles délégations municipales. Charles Reverchon-Billot est ainsi devenu maire adjoint aux « droits culturels », terme englobant l’ensemble des droits humains universels. Un élu a hérité d’un portefeuille tout aussi abstrait, baptisé « ville accueillante », un autre est assigné au « patrimoine à énergie positive », celui-ci à la « commande publique responsable ...
Le « zéro déchet », la « bientraitance animale » et l’ « éducation nature » sont aussi, désormais, des délégations en tant que telles. Tout comme l’ « innovation démocratique », attribuée à la première adjointe. Celle-ci porte un projet majeur de la nouvelle équipe, dont la moyenne d’âge tourne autour de 40 ans : créer, d’ici un an, une « assemblée citoyenne » de 150 habitants, qui aura son mot à dire au conseil municipal.
L’idée fait sourire amèrement l’ancien maire Alain Claeys, 72 ans, initiateur de diverses structures participatives durant sa mandature. « Beaucoup d’horizontalité est nécessaire à la vie démocratique mais il faut aussi de la verticalité, ne serait-ce que pour décider », formule-t-il, façon de dire qu’il doute de la capacité de sa remplaçante à diriger une majorité plurielle mêlant militants de gauche (EELV, Génération Ecologie, PCF, Génération.s, Nouvelle Donne, A nous la démocratie !) et société civile.
Férue de langues étrangères et de théâtre contemporain, Léonore Moncond’huy le sait : son inexpérience et sa jeunesse lui seront rappelées au moindre faux pas. A ceux qui la trouveraient trop lisse, elle explique être « radicale sur le fond, et non sur la forme », persuadée « que le meilleur moyen d’avancer n’est pas la confrontation, mais de mettre tout le monde autour d’une table . La concertation, la bienveillance, l’exemplarité : autant d’idéaux façonnés au sein des Eclaireurs.
Une véritable profession de foi, le scoutisme. Des étoiles brillent dans ses yeux pour évoquer la rosée du matin qui scintille devant la tente et les Chamallows qui caramélisent sur le feu de camp : « Je ne connais rien de mieux pour souder un groupe et redonner confiance en l’humanité. » Léonore Moncond’huy ne croirait pas aux vertus de la vie au grand air, jamais elle n’aurait affecté sa première enveloppe de maire (200 000 euros) à l’envoi en vacances, cet été, de 1 500 enfants et adultes n’ayant pas les moyens de partir.
La même année que ses débuts chez les scouts, la collégienne remporte sa toute première élection en accédant au conseil communal des jeunes (CCJ) de Poitiers, version junior du conseil municipal. Elle poursuivra avec le bureau des jeunes, réservé aux plus de 15 ans. L’organisation de voyages en Europe de l’Est et un sondage auprès des adolescents d’un quartier promis à la réhabilitation figurent parmi ses réalisations. « C’est par la pratique qu’elle a forgé ses convictions », se souvient Karine Trouvat, l’animatrice du CCJ.
« Elle sait où elle va »
Sa mère, professeure documentaliste ayant connu un mandat de conseillère municipale (Verts) entre 2004 et 2007, a aussi joué un rôle, en l’emmenant manifester avec elle, enfant, contre la mise en service de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne). Son père, professeur de littérature française du XVIIe siècle à l’université de Poitiers, lui a appris « à ne pas compter [ses] heures » et à donner « du sens aux projets . En 2014, la liste Verte de Christiane Fraysse cherche une petite main pour les municipales.La fille d’Elisabeth et de Dominique est embauchée. « Elle a été une secrétaire hors pair, se souvient Robert Rochaud, militant écolo de la première heure, aujourd’hui adjoint aux finances. Je la trouvais alors plus brillante que Cécile Duflot quand elle a pris la tête des Verts à 31 ans. »
Tout ira ensuite très vite. Elle adhère à EELV dans la foulée des municipales, se fait élire aux régionales de fin 2015 puis est propulsée, deux ans plus tard, à la coprésidence du groupe écologiste du conseil régional, partie prenante de la majorité. Elle s’y distinguera par ses prises de parole musclées, réclamant au président socialiste Alain Rousset de verdir sa politique. « Ce qui frappe, chez elle, c’est une intelligence au cordeau qui lui permet d’allier radicalité et responsabilité. Elle sait où elle va », loue Nicolas Thierry, future tête de liste EELV aux régionales de mars 2021.
Pour sa ville, « Léonore du Poitou » - qui a refusé de cumuler avec la présidence de l’agglomération Grand Poitiers, confiée à la maire divers gauche de Migné-Auxances, Florence Jardin voit grand. Et vert. Elle compte planter 200 000 arbres, créer un « centre éducation nature », freiner le développement des zones commerciales, fermer l’aéroport... « La transition écologique ne peut pas être douce et gentille, nous sommes dans l’urgence. J’appartiens à la première génération politique qui va devoir gérer un héritage dont elle n’est pas responsable », martèle celle que rien n’indigne plus, actuellement, que la mode des SUV. Une autre de ses initiatives, sitôt maire, fut de suspendre le permis de construire d’un projet immobilier, jugé insuffisamment vertueux sur le plan environnemental.
Mais l’euphorie des premiers jours a aussi entraîné une légère cacophonie au sein de sa majorité. Une adjointe s’est ainsi demandé, sur Twitter, s’il n’était pas temps de modifier le terme d’ « école maternelle », trop « genré » - tollé sur les réseaux sociaux. Une autre, dans La Nouvelle République, s’est aventurée à évoquer l’introduction de temps de « non-mixité » dans les équipements sportifs sujet brûlant s’il en est... Et quand Le Monde a rencontré Robert Rochaud, celui-ci a certifié que la ville annulerait la commande d’une oeuvre d’art d’un montant de 200 000 euros, passée par l’équipe précédente. Rétropédalage deux jours plus tard : « Rien n’est encore décidé... »
Léonore Moncond’huy sait aussi que la communication jouera un rôle primordial tout au long de son mandat. Ne l’a-t-elle pas démontré en promettant, il y a deux mois, de participer à un tournoi de basket si l’un de ses Tweet atteignait plus de 1 000 « like », et un Retweet du joueur NBA et ex-Poitevin Evan Fournier ce qui fut fait en quelques heures ? Le tournoi s’est déroulé début septembre, au Jardin des plantes. Avant d’entrer sur le terrain (et subir deux défaites sans appel), madame la maire s’est plu à citer Kobe Bryant, légende des parquets disparue en janvier dans un accident d’hélicoptère : « On n’abandonne pas, on ne bat pas en retraite, on ne fuit pas. On résiste et on conquiert. » Parole de scout.