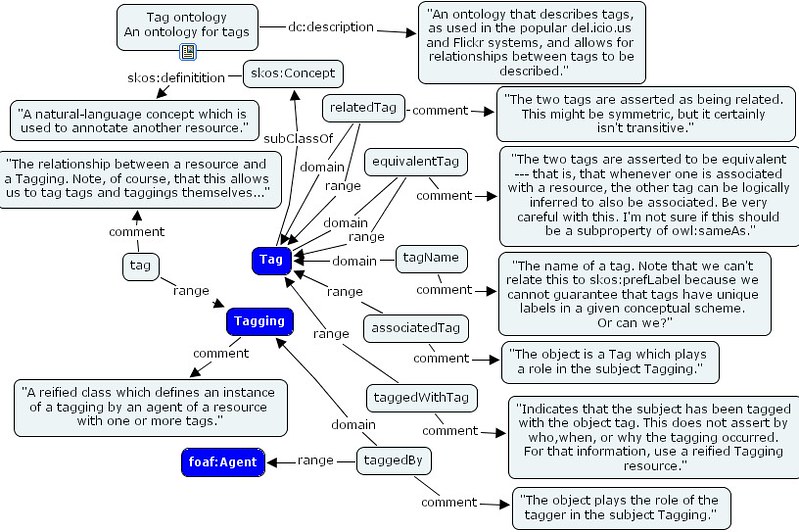Quel voleur accepte qu’on le vole ? #Capitalisme et #propriété privée
▻http://i2d.toile-libre.org/PDF/2011/i2d_capitalisme_propriete.pdf
un extrait :
Comment comprendre la quête effrénée d’Achab, sinon comme la tentative déses- pérée de s’attacher ce qui est fondamentalement inattachable, c’est-à-dire ce qui est toujours perdu d’avance ? « Je l’ai marquée, vociférait-il pourtant. M’échappera-t-elle ? » Car Moby Dick, qui avait fauché la jambe du capitaine du Péquod « comme un moissonneur fauche une tige dans un champ », c’est-à-dire comme un glaneur amoureux cueille la première rose qui lui tombe sous la main, portait elle-même les stigmates de toutes les attaches manquées, harpons tordus et tournés dans son corps, hampes brisées de lances sortant de son dos, emmêlements de lignes qu’elle portait comme une charge ficelée sur elle. Et la tête blanche de la baleine, avec son front ridé, n’était-elle pas en quelque sorte le grand livre ouvert de l’histoire, où se rejouait indéfiniment la même ritournelle, celle des hommes qui voulaient harponner tous les météores, vagabondant sur le corps plein de la terre, et les météores qui continuaient leur course sous le vent, d’une allure paisible de voyageur, indifférents à tant d’efforts ?
Il fallait s’y faire. L’âme humaine évoluait entre l’une et l’autre de ces deux #dispositions contraires, incapable de se poser jamais, se réclamant de la première quand on lui opposait la seconde, et récipro- quement, du moment que le vol était possible, et qu’on ne se fît pas voler en retour. (Le gantier suggérait ici que les #contradictions, bien mieux que d’empêtrer les hommes, étendaient au contraire leur #pouvoir et leur champ d’action.) En d’autres termes, chaque individu s’arrogeait le privilège de l’invention, en le déniant catégoriquement à autrui, afin de pouvoir #jouir de ses trouvailles en solo. Les hommes voulaient voler sans être volés, ils voulaient pouvoir se servir sans que les autres se servissent après eux. En ce sens, saint Augustin avait simplement répété ce que d’autres avaient dit avant lui : l’homme était un être de contradiction, une créature bicéphale, voguant inexorablement entre la souille et l’éther, entre la gloire et l’infamie. Et l’#économie_de_marché, dont le gantier connaissait les multiples ressorts, pour l’avoir vue se déployer dans toute sa splendeur à travers la mécanique à écraser le monde qu’avait inventée Mouret, l’économie de marché avait trouvé dans cette contradiction le principe #dynamique qui allait lui permettre d’assurer son implacable empire.
En effet, le capitalisme avait fait d’une double disposition psychologique au libre picorement et à l’#accaparement le ressort de toute une politique. Pour Mignot, le capitalisme était un naturalisme, il suivait l’âme sur le chemin de sa chute naturelle, reproduisant à l’échelle molaire les mécanismes de la #subjectivité humaine. Pour faire simple, le capitalisme flattait le petit voleur qui ne veut pas être volé présent en chacun de nous, tout en s’assurant d’empocher le pactole, au bout du compte. Pouvoir voler sans risquer d’être volé en retour, voilà en effet le principe général qui avait présidé au mouvement des « #enclosures » — c’est-à-dire à l’expropriation hors de leurs terres des producteurs ruraux et des masses populaires anglaises —, secret de l’#accumulation_initiale du début du xvie siècle, analysée par Karl Marx à la fin du premier livre du Capital ; mouvement dont Hannah Arendt avait montré par la suite qu’il constituait la #logique_structurelle du capital. Car chaque clôture, chaque haie, chaque bouledogue, chaque vigile, chaque brevet, chaque article du Code civil tendaient à leur manière à résoudre la terrible question augustinienne. À ce titre, le droit, qui était une technique parmi tant d’autres, s’efforçait toutefois de les surcoder toutes, en les réenveloppant dans son écheveau de lois, de décrets et de jurisprudences. Et qu’est-ce que le droit de propriété, demandait Mignot, sinon le droit pour un individu d’interdire à un autre individu de lui voler ce qu’il a lui-même extorqué à un tiers ?
Pour résumer ce qui venait d’être dit, et marquer les consciences, Mignot annonçait, imperturbable, que le capitalisme était le système politique qui organisait les conditions de monopole du vol légitime ; c’est-à-dire les conditions permettant de conjurer l’#ontologie_des_biens_épaves, au profit d’une petite clique, qui réglait les modalités de la mainmise — décidément, l’étymologie plaidait en faveur des propos du gantier. Car toute propriété consacrée par le droit était un fait d’empiètement, pareil à celui d’un arracheur de bornes, une institution de l’#égoïsme, dont le seul résultat avait été de déposséder la multitude au profit de cette caste, et que le législateur avait tout naturellement consacrée, puisqu’il en faisait partie lui-même ; l’histoire était connue de chacun. Simplement, on avait décidé un beau jour, en haut lieu, qu’un certain vol était légitime et qu’un autre ne l’était pas. On avait pris les dispositions pour encourager le premier et pour punir le second — et c’en fut fait de l’ontologie.
Mignot invitait ses auditeurs à faire l’expérience de pensée suivante. Que chacun imaginât un domaine terrien existant, entouré de larges murailles ou de hautes clôtures, et reculât peu à peu dans le temps, en parcourant à l’envers l’enchaînement des héritages et des successions. Et où arrivait-on au bout du compte ? Au vol, pardi ! Au plus loin que l’on remontât, toute propriété terrienne était le fait d’un #vol_originaire, d’une confiscation primitive ; il avait bien fallu, avant qu’elle appartînt à un seul individu à l’exclusion de tous les autres, que celui- là s’en autoproclamât un beau matin le seigneur. Dominium fiat ! Où que l’on regardât autour de soi, champs, jardins, domaines, rien qui n’eût d’abord été spolié, en toute connaissance de cause, à la nature, et donc à la #communauté des hommes. La manœuvre était commode : il n’y avait pas d’autre chemin, pour passer des grands espaces, ouverts aussi loin que portait la vue, aux actes de Monsieur le notaire, que le chemin du pillage ; et certains n’avaient pas hésité, comme condition de cette odieuse usurpation, à expulser ceux qui s’étaient trouvés là, à brandir de fallacieux titres de propriété ou à pointer sur leurs visages les canons de leurs fusils — et à tirer, ô accumulation initiale.
Et ce qui valait pour les terres, valait pour les choses, pour les gants par exemple, les gants de chevreau, les gants Bonheur, les gants de Suède ou de Saxe. Les États capitalistes, qui transformaient magiquement les biens épaves en corps-morts, refusaient identiquement que les produits du travail fussent mis en jeu, sur le grand tapis de la roulette planétaire. Mieux, ils l’acceptaient une fois, le temps de les prendre (voler), et le refusaient ensuite à tous les hommes (sans être volé). Le gantier avait noté que tous les corpus de lois, depuis les premiers errements du droit romain, jusqu’aux infinis articles du fastidieux Code civil, allouaient les res nullius à l’amiral d’Angleterre, aux seigneurs, aux États et aux Empires, c’est-à-dire, un soupçon de jugeote suffisait pour tirer cette conclusion édifiante, à ceux-là mêmes qui les avaient rédigés ! Le capitalisme organisait la #captation monopolistique des res nullius et des terra nullius . Et Melville rappelait encore le latin des livres de lois de l’Angleterre : De balena vera sufficit, si rex habeat caput et regina caudam . Autrement dit, de toutes les baleines capturées sur les côtes de ce pays, le roi devait recevoir la tête, et la reine la queue. Et le gantier poursuivait sa lecture de Moby Dick : « Pour la baleine, cette division est à peu près comme si on partageait une pomme en deux : entre les deux parts, il ne reste rien. » C’était là la contribution de la mer. La mer payait impôt à l’Angleterre — Flotson , Jetson et Lagon .
En somme, la classe possédante jonglait astucieusement entre le fait et le droit, entre le statut de poisson attaché et celui de poisson perdu. C’était même très exactement le rôle des États : surcoder toutes les épaves de la terre pour les soumettre au pouvoir d’un maître du surplus ou du stock, qui en réglait l’appropriation monopolistique et la prétendue redistribution. Et non seulement les objets, mais les forêts, les pays, les continents, les étoiles elles-mêmes étaient des poissons perdus, et aussitôt après des poissons attachés. L’accumulation primitive était permanente et ne cessait de se reproduire, pour réaliser le but suprême du capitalisme : introduire le #manque là où il y avait toujours trop, par l’absorption des ressources surabondantes. Et cela valait également pour le travail, et pour la monnaie. Car dès lors qu’une chose possédait le premier statut, celui de poisson perdu, celui de #flux libre ou « décodé », pour parler comme les deleuziens, dif- férents « #appareils_de_capture » (#rente, #profit, #impôt) avaient été montés pour lui donner immédiatement le second. Les États s’arrogeaient en vérité l’appropriation monopolistique de la capture elle-même. Dans ces conditions, ils admettaient l’ontologie des biens épaves pour mieux la #corrompre ; ils se nourrissaient d’elle, ils la parasitaient. Mais pour ce faire, il fallait également procéder à l’opération inverse, c’est-à-dire décoder les flux qui avaient été codés une première fois, par d’autres formations sociales ; autrement dit : rendre leur statut de poissons perdus aux poissons attachés, pour les intégrer sur-le-champ à une #axiomatique de classe ; décoder et reco- der — quel voleur accepte qu’on le vole ?
Et c’était ça, le capitalisme. Ce décodage généralisé des flux, pour en capter la plus-value, et leur incorporation dans une axiomatique permettant d’en contenir les puissances révolutionnaires , ce qui demandait l’aide d’une gigantesque machine répressive, qui recodait à tour de bras, à coups de dictature mondiale et de #police toute-puissante. Car partout, le capitalisme repoussait et conjurait sa propre réalité, les flux décodés, conscient que le décodage achevé des flux, leur fuite hors de l’axiomatique sociale, c’est-à-dire la #déterritorialisation absolue des objets et des hommes, coulant sur le corps plein sans organes, constituait sa limite externe. Et peut-être que ce retour à une ontologie d’objets trouvés, que Mignot prônait haut et fort, était la « voie #révolutionnaire » dont parlaient Gilles #Deleuze et Félix #Guattari. Non pas se retirer du marché mondial, mais « aller plus loin encore dans le mouvement du marché, du décodage et de la déterritorialisation ». Non pas se retirer du procès, mais accélérer le procès, en prenant la #décision, universellement concertée, de décoder tous les flux, une fois pour toutes, et partant d’abandonner les objets à leur fortune de poissons perdus, flottant librement entre le noyau terrestre et la stratosphère, dans les limbes éthérées de la planète bleue.
Mignot sortit de sa sacoche un récent best seller, qu’il avait lu quelques mois plus tôt, et qui s’appelait La Soute, ou La Route. L’homme et l’enfant marchaient dans un pays qui avait été ratissé et pillé des années plus tôt, poussant laborieusement leur caddie, dont l’une des roues était près de lâcher. L’homme et l’enfant marchaient dans un monde gris et nu, où tout était recouvert de cendres. Et le gantier avait compris que cette « terre carbonisée », cette « terre de rien », « dépouillée de la moindre miette », longuement décrite par Cormac McCarthy, c’était le monde que le capitalisme abandonnait aux hommes, après qu’il l’avait dévalisé de fond en comble. L’odyssée de l’homme et de l’enfant, c’était simplement la vie en milieu postcapitaliste, ou hypercapitaliste, ça revenait au même ; la vie dans un monde vidé de ses épaves, un #monde où il n’y avait plus rien à #glaner, sinon quelques boîtes de conserves anonymes, qui avaient miraculeusement échappé au désastre. Toujours leurs mains reve- naient vides, et toujours ils les lançaient, au-devant des introuvables reliques de la civilisation, comme des fossoyeurs retournant obstinément les cimetières, pour en exhumer un cœur qui bat. Car c’était tout ce qui les tenait en vie, l’un et l’autre, rester des inventeurs, coûte que coûte, des batteurs de grèves, en quête de l’#abondance d’un monde disparu. La Joute était une dérive indéfinie dans les économats de l’enfer, à travers l’axiomatique capitaliste, et c’était comme ça tout au long du livre : chercher (tout ce qui pourrait servir), trouver (rien, presque rien), prendre (une boîte de pêches en conserve), jeter, chercher encore, etc. Et même, c’était parce qu’il n’y avait plus rien à cueillir que l’homme et l’enfant se méfiaient des autres survivants, des autres fouilleurs de ténèbres, comme eux mis à nu, et prêts à leur soutirer le peu de vivres qui traînait au fond du caddie, prêts à les condamner à mort. Et Mignot jubilait : C’était parce que le capitalisme organisait d’abord les conditions de la #rareté dans le monde, que le vol était non seulement possible, mais surtout nécessaire, pour tous ceux qui cherchaient en vain leur nom sur la liste des invités d’honneur, pour prendre part au grand régal du marché des changes ! Et la question qu’avaient posée Deleuze et Guattari n’était pas de savoir pourquoi les #travailleurs #pauvres, les démunis, les affamés volaient ; non, la question était de savoir pourquoi les travail- leurs pauvres, les démunis, les affamés ne volaient-ils pas toujours ?
▻http://pontcerq.toile-libre.org/007%20mignot.htm
#éditions_Pontcerq #livre_en_ligne