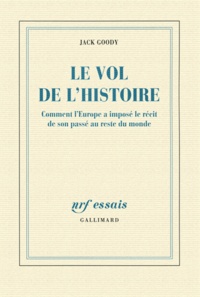"Antisémitisme et Antisionisme - L’impossible amalgame"
Il y a dans la réaction « anti-israélienne » plus et parfois autre chose qu’une attitude politique de gauche, commandée par la lutte contre l’impérialisme. Il y a aussi et il y a parfois surtout une défense de l’intelligence devant l’assaut qui est continuellement livré, une réponse de l’esprit critique au défi qui le confronte presque en permanence dans ce débat plus chargé de passion et de fanatisme que nul autre.
En 1967, l’opinion publique occidentale a été soumise à un bombardement systématique dont les munitions avaient été savamment sélectionnées par de savants artilleurs. Le combat que livrait Israël était présenté comme celui d’une petite nation faible entourée d’ennemis nombreux et puissants - David contre Goliath - et ne souhaitant rien d’autre que le droit à l’existence.
On s’est vite rendu compte que le rapport des forces entre Israël et ses alliés, d’une part, et ses ennemis arabes, de l’autre, jouait entièrement en faveur d’un Etat développé qui n’a eu aucune peine à écraser une série d’adversaires également faibles et misérables - misérables donc faibles.
En juin 1967, l’Etat d’Israël a affirmé ne faire la guerre (préventive) - préventive, mais rappelez-vous le titre qui, le 5 juin 1967, barrait la première page de France Soir- plus gros tirage de la presse francophone dans le monde - :
« L’Egypte attaque » - que pour assurer sa survie physique et empêcher son étouffement économique. Or, aujourd’hui et depuis deux ans déjà, la Jordanie et l’Egypte sont disposées, moyennant le retrait des troupes israéliennes, à des concessions qui ne signifient rien d’autre que la reconnaissance de fait de l’Etat hébreu ; elles acceptent en outre qu’Israël bénéficie désormais de la liberté de navigation. Mais la paix est plus éloignée que jamais : les Israéliens désirent actuellement des « frontières sûres » et il n’est plus question pour eux de revenir aux limites territoriales qui étaient les leurs avant la guerre des six jours. Les aspirations d’Israël peuvent difficilement être présentées comme celles, élémentaires et légitimes, d’un Etat ne nourrissant, à l’exclusion de toute ambition territoriale, qu’un désir pathétique de dialogue, de reconnaissance et de paix.
Moins désarmée sur ce terrain que dans le passé, l’opinion publique se voit à présent confrontée avec une argumentation d’un tout autre genre. Elle tient en peu de mots : l’antisionisme ne serait qu’une variante de l’antisémitisme ; l’opposition à Israël rien d’autre qu’une version de la haine des Juifs. Il y a des mois qu’on nous le répète et M. Michel Soulié, vice-président du Parti radical-socialiste, vient de déclarer pour sa part : « Aujourd’hui, personne n’ose plus s’affirmer antisémite, mais l’antisionisme est un bon paravent pour la droite et aussi une certaine nouvelle gauche »1.
On objectera : M. Michel Soulié et le Parti radical-socialiste méritent-ils les honneurs de la citation ? Pour ce qu’ils représentent... Sans doute, sans doute.
Mais le Nouvel Observateur de M. Jean Daniel ?... Voilà des semaines qu’on y trouve des mises en garde pleines de sollicitude à l’adresse de la gauche, ancienne et nouvelle, menacée, dit-on, de verser dans l’antisémitisme en raison de son opposition à Israël. Et tout de même, le Nouvel Observateur malgré tout, ce n’est pas le Parti radical-socialiste... Cet amalgame affirmé, ou suggéré, systématiquement entretenu entre l’antisionisme et l’antisémitisme, est devenu une arme politique.
On est tenté de ne lui répondre que par le haussement d’épaules qu’il mérite. Mais on ne peut plus aujourd’hui se contenter de cette réaction. Une prise de position claire est indispensable, basée sur l’analyse et la réflexion. En cette matière encore, la gauche, inlassablement, doit faire oeuvre démystificatrice.
La logique de l’histoire
Que la haine des Juifs puisse conduire à celle d’Israël, il faut le constater. II en est ainsi, par exemple, de quelques milieux d’extrême droite en Allemagne, représentés par la Deutsche Soldatenzeitung et par l’ancien condottiere S.S. Skorzeny, que la haine antijuive conduit à soutenir la cause palestinienne.
Dans un même ordre d’idées, mais par un phénomène apparemment inverse, la Pologne offre l’exemple d’un régime où l’antisionisme - véritable ou feint - conduit à l’antisémitisme et sert, en fait, de diversion à une politique impopulaire. Notre propos est cependant de prouver que la liaison entre l’antisionisme et l’antisémitisme est l’exception, tandis que le lien entre le sionisme et l’antisémitisme est plus fréquent et moins fortuit. Ce lien entre l’antisémitisme et le sionisme est double, de nature logique et historique.
Ce lien est logique. Ecoutez le langage classique de l’antisémitisme : l’élément juif est inassimilable, constituant dans les nations où il s’est introduit un corps étranger, nécessairement étranger, il doit en être isolé et si possible évacué. Ce raisonnement s’est souvent exprimé de manière très lapidaire : « les Juifs dans leur pays ». Or, les sionistes ne disent rien d’autre.
A les en croire, l’élément juif est inassimilable à cause du caractère inéluctable de l’antisémitisme. Theodor Herzl, le fondateur de la doctrine, ne fait sur ce point aucun mystère de ses convictions :
« Parmi les populations, l’antisémitisme grandit de jour en jour, d’heure en heure, et doit continuer à grandir parce que les causes continuent à exister et ne sauraient être supprimées » 2.
Quant à la formule lapidaire, « les Juifs dans leur pays », on la retrouve dans le programme du sionisme : elle résume en même temps qu’elle en traduit toute la politique.
L’antisémitisme et le sionisme nous confrontent avec un courant également antilibéral et également pessimiste, ils sont unis par la même opposition à une idéologie démocratique qui croit, parfois naïvement, au nécessaire et possible rapprochement des communautés ethniques, religieuses, etc.... Et il s’agit moins ici de justifier ou de dénoncer ce pessimisme que d’en constater la présence significative et dans le projet sioniste et dans la mentalité antijuive.
Or, l’histoire confirme la logique, et ce dès l’aube du mouvement sioniste.
« D’honnêtes antisémites devront être associés à l’oeuvre (sioniste) pour y exercer en quelque sorte un contrôle populaire, tout en conservant leur entière liberté, précieuse pour nous »3.
Ces paroles et la justification d’un antisémitisme « honnête », accompagnée de la revendication, pour ceux qui le pratiquent, d’une « liberté précieuse », sont de Herzl luimême.
Le fondateur du sionisme n’a pas précisé ce qu’il entendait par des antisémites « honnêtes », mais dans les faits, il a accordé des brevets d’honnêteté à des antisémites dont la liberté est loin d’avoir été précieuse pour les Juifs. C’est ainsi qu’il a - à la grande indignation des Juifs de l’époque - rencontré, en 1904, Plehve. le ministre de l’intérieur de la Russie tsariste, celui-là même que la communauté juive de Russie tenait, non sans raison, pour responsable du terrible pogrom de Kichinev. Plehve promit d’ailleurs à Herzl, « un appui moral et matériel au jour où certaines... mesures pratiques serviraient à diminuer la population juive de Russie » 4.
Il n’est pas exclu qu’un calcul analogue ait inspiré Lord Balfour, dont la célèbre déclaration assura l’appui décisif de la Grande-Bretagne à l’entreprise sioniste, puisqu’il n’hésita pas à se faire élire, à la Chambre des Communes, sur une plateforme comprenant un projet de loi interdisant l’émigration en Angleterre et, singulièrement, l’émigration juive.
Ces citations et ces faits, pour troublants qu’ils soient, seront acceptés avec moins de gêne que la révélation de la collaboration qui se pratiqua entre sionistes et nazis. Pourtant, l’évidence est là. Ces actes de collaboration se déroulèrent tour à tour en Allemagne, en Autriche et en Hongrie et trouvèrent un défenseur convaincu en la personne d’Eichmann qui, converti au sionisme par la lecture de Herzl, se mit, selon le témoignage de la sociologue américaine Hannah Arendt, « à répandre le message sioniste dans les milieux S.S. » 5.
Ses efforts ne furent pas tout à fait vains puisqu’il réussit à convaincre beaucoup de ses camarades que « les sionistes étaient les Juifs "décents", puisque, eux aussi, pensaient en termes "nationaux" » 6.
Un livre récent, s’appuyant sur des documents d’archives et rédigé par un auteur israélien, offre de cette collaboration entre nazis et sionistes - et en particulier de la complaisance relative, mais certaine, des hitlériens envers le sionisme - un faisceau de preuves convergentes. 7
"Vive Israël, mort aux Youpins !"
Ce sont là, dira-t-on, des cas extrêmes. Sans doute. Mais, plus près de nous, historiquement et géographiquement, la collusion entre l’antisémitisme et le sionisme ou la sympathie pour Israël, a frappé un observateur aussi peu suspect d’hostilité envers l’Etat hébreu que Marc Hillel. Parlant des événements de 1956, il reconnaît dans son livre que « !es antisémites les plus irréductibles deviennent pro-israéliens tout en continuant à détester leurs Juifs » 8
et, à propos des cortèges pro-israéliens qui se déroulèrent à Paris en juin 1967 :
« on nota la présence de membres de l’extrême droite antisémite par tradition aux manifestations en faveur d’Israël » 9.
Personne ne sait si les antisémites du genre de Xavier Vallat, ancien commissaire de Vichy aux Affaires juives, qui, en 1967, eut ce cri du coeur « Vive Israël, mort aux youpins ! », personne ne sait si ce genre d’individus forme ou non une catégorie nombreuse. Mais Vallat ne doit pas être tout à fait isolé dans son désir de voir prospérer les Juifs dans un « pays à eux » qui aurait l’immense mérite de débarrasser de leur présence les Etats où ils sont fixés.
Et pour ce qui est de la France particulièrement, on ne peut nier que la sympathie proisraélienne est alimentée depuis longtemps par la haine des Arabes et le désir de voir la défaite d’Algérie vengée aux dépens de Nasser et de ses alliés. Aspiration si profonde qu’elle a fait de partisans de l’Algérie française connus pour leur haine des Juifs des admirateurs passionnés de la virilité israélienne. Tixier-Vignancour se trouve, par exemple, dans ce cas.
En regard de la liaison logique et historique entre le racisme antijuif et la sympathie pour le sionisme, il faut, au contraire, opposer cette autre considération de fait : l’histoire du sionisme a longtemps été l’histoire de la lutte menée contre cette idéologie par des mouvements juifs. Les Juifs antisionistes se recrutaient, en effet, nombreux soit dans les milieux religieux qui n’envisageaient le retour des Juifs vers la « Terre promise » que sous une forme spirituelle, soit dans les milieux socialistes où l’on entendait unir les ouvriers juifs et non juifs dans le combat contre le capitalisme que l’on rendait responsable de l’antisémitisme. A quoi il faut ajouter la longue série de personnalités juives et non juives qui, peu suspectes d’antisémitisme, ont mené ou mènent la lutte contre le racisme et se posent en adversaires résolus de l’entreprise sioniste et de l’Etat d’Israël : liste interminable qui comprend les noms de Bertrand Russel. Isaac Deutscher, Erich Fromm, Mehdi Ben Barka, Rudi Dutschke, Elridge Cleaver, etc., etc. II ne s’agit d’ailleurs pas seulement de personnalités, mais de mouvements et de courants d’opinion. Ce sont les étudiants allemands radicaux de la S.D.S. qui se montrent les plus achamés dans le combat contre les séquelles du nazisme et dans l’opposition à Israël. Ce sont les formations et « groupuscules » d’extrême gauche qui, en France, sont le plus résolument opposés à l’israélophilie dont P. Viansson-Ponté disait récemment dans Le Monde qu’elle était surtout le fait de l’"establishment" français 10.
Or, ces mêmes formations et « groupuscules », qui pourrait les accuser de complaisance envers le racisme en général ou, en particulier, envers l’antijudaïsme ?
Le sionisme contre les Juifs
On rétorquera à tout cela que s’en prendre à Israël, c’est nécessairement s’en prendre aux Juifs puisque, dans leur très grande majorité, les Juifs sont profondément attachés à l’Etat sioniste.
La gauche antisioniste ne peut laisser sans réplique un tel argument. Elle doit y répondre en montrant que, si elle s’oppose à l’entreprise sioniste, c’est parce que celle-ci est nocive non seulement aux Arabes, mais également aux Juifs. La première proposition se passe de démonstration, le sort des Palestiniens que l’implantation sioniste en Palestine a chassés de leur pays témoignant suffisamment de sa justesse. Il est plus important d’insister sur ce fait : nous autres qui critiquons et rejetons le sionisme, nous le faisons non par hostilité envers les Juifs, mais, bien au contraire, par refus de tout racisme, qu’il soit dirigé contre les Arabes, contre les Juifs ou contre toute minorité nationale ou ethnique.
Notre critique du sionisme est double et se place sur le plan des principes et sur celui des réalités concrètes. Des principes parce que la composante raciste du sionisme, pour ne pas être évidente et perçue par tous, n’en est pas moins certaine. Nous l’avons dit, le sionisme mise sur le caractère inéluctable de l’antisémitisme. C’est son postulat de base. Lorsque les Juifs sont menacés de persécution, les sionistes les invitent a rejoindre la Palestine, avec le consentement ou contre le gré (et en l’occurrence, contre le gré) des populations autochtones. Réflexe de défense, dira-t-on. Mais peut-on raisonnablement suggérer que la solution des nombreux problèmes que crée la tension entre communautés ethniques, religieuses ou nationales cohabitant sur un même territoire se trouve dans le départ de ces communautés ? Or, c’est cela la « solution sioniste ». Appliquée à d’autres cas, elle conduirait à pousser les minorités noires, irlandaises, espagnoles, etc.. etc., au départ, comme si le règlement du problème du racisme dans le monde se trouvait dans d’immenses mouvements migratoires ramenant « chez eux » les noirs, les Irlandais, les Espagnols et les Juifs. A ces derniers, le sionisme ne propose rien d’autre. C’est une proposition insoutenable.
Mais s’agit-il seulement d’une réplique (au demeurant inadéquate) à un péril physique et à une menace de persécution ?
Non, le sionisme est bien plus que cela. S’adressant récemment à des Juifs américains, Mme Golda Meïr n’a-t-elle pas déclaré que c’est " seulement leur immigration en Israël (qui) peut les sauver de l’assimilation " 11.
Le danger que le sionisme est censé combattre, ce n’est donc plus la spoliation, la discrimination antijuive ou l’extermination des Juifs, mais leur « assimilation » au sein des nations. Il serait utile de préciser ici ce qu’on entend par « assimilation » et qui, si l’on excepte l’hypothèse condamnable d’une assimilation forcée, ne peut être que l’intégration harmonieuse d’une communauté au sein de la population qui l’environne. Et, une fois de plus, nous nous heurtons à cette analogie entre le langage des sionistes et celui des antisémites : il faut rejeter, comme impossible ou pernicieuse, i’assimilation des Juifs, le maintien de leur spécificité est une exigence si impérieuse qu’elle justifie leur émigration.
Certes, il n’y a rien en commun entre le sionisme et le nazisme et il faut à ce propos, regretter les formules mensongères et donc nocives identifiant Israël à un Etat fasciste et sa politique à l’hitlérisme. Mais il reste que, d’une certaine manière, le sionisme a pris le relais de l’antisémitisme. Ce dernier incitait les Juifs au départ ou au repli sur soi. Le sionisme ne fait rien d’autre et la politique qu’il mène à cet égard est, pour les Juifs, riche de périls. II tente de les persuader qu’ils sont non seulement citoyens du pays où ils sont fixés, mais aussi et même surtout citoyens d’Israël, liés à cet Etat par un devoir de civisme et une allégeance imprescriptible. Sont taxés de trahison envers leur peuple ceux qui nient ce devoir et rejettent cette allégeance.
Tant qu’il n’existe pas de différend important entre Israël et tel ou tel Etat où habitent des Juifs, ce principe d’allégeance peut n’apparaître que comme un fait sentimental secondaire. Mais lorsque la conjoncture internationale suscite entre l’Etat d’Israël et d’autres pays une tension ou un conflit, le problème cesse d’être de nature purement affective. Il est politique. On voit, dès lors, le grand rabbin de France prendre ouvertement position contre l’attitude de son pays ou de son gouvernement envers Israël - qui n’est pas son pays - et une série d’associations juives adopter un comportement semblable qui, faut-il le dire n’a rien à voir avec un quelconque sentiment d’internationalisme, mais dérive d’un attachement inconditionnel envers un Etat étranger.
Les antisémites ont toujours prétendu que les Juifs ne voulaient pas s’intégrer dans les pays où ils vivaient. C’était une contrevérité. Mais voila que, par l’effet d’une propagande systématiquement organisée, un grand nombre de Juifs se prêtent eux-mêmes à une opération qui les fait apparaître comme les nationaux d’un Etat étranger. Qui n’aperçoit l’utilisation que l’antisémitisme peut faire d’une situation aussi équivoque et aussi malsaine ? L’actualité ne souligne pas ce péril dans nos pays.
A la grande majorité des Français et des Belges, pour ne prendre que leur cas, Israël apparaît, consciemment ou non, comme la revanche de l’homme blanc et de l’Européen contre l’homme de couleur coupable d’arrogance. D’ou sa popularité actuelle.
Devant un tel état de choses, le rôle de la gauche est double : il consiste tout d’abord à rétablir les faits et à montrer quel est le rôle véritable de l’Etat d’Israël et à défendre les peuples qui sont victimes de sa politique. Le devoir de la gauche antiraciste est aussi de montrer qu’à la faveur d’un retournement dans l’opinion publique, l’israélophilie actuelle peut disparaître (d’autant qu’elle n’a pas de fondement sérieux) et faire place alors à une hostilité qui, à défaut de prendre pour cible l’Etat hébreu lui-même, s’en prendra aux communautés juives qui y sont inconditionnellement attachées. Cette hypothèse est lourde d’un péril qu’il faut à tout prix combattre : celui d’une renaissance de l’antisémitisme.
Non, les antisionistes ne sont pas antisémites. L’amalgame qu’on nous suggère et que l’on veut de plus en plus nous imposer ne repose sur aucune analyse sérieuse. Ne serait-il rien d’autre qu’une forme de chantage moral et intellectuel par lequel on voudrait empêcher tous ceux qui condamnent la haine antijuive, criminelle et imbécile, à ouvrir le dossier israélo-arabe et à l’examiner avec un minimum d’objectivité ? Il y a, dans l’argumentation utilisée à ce propos, trop de mauvaise foi pour qu’on puisse rejeter cette hypothèse.
Marcel Liebman
[MAI N°10 février 1970]
Bibliographie
1 Le Monde, 23-1-1970
2 T. Herzl, l’Etat juif, éd. Lipschitz, Paris, 1926, p.84. Souligné par nous.
3 Ibid., p. 137.
4 M. Bernfeld, Le sionisme. Etude de droit intemational public ; Paris, Jouve, 1920, p. 399.
5 H. Arendt, Eichmann à Jérusalem ; Paris, Gallimard, 1963 ; p. 52.
6 Ibid., p. 73.
7 E. Ben-Elessar, La diplomatie du IIIe Reich et les Juifs (1933-1939), Paris. Julliard, 1966.
8 M. Hillel, Israël en danger de paix ; Paris, Fayard, 1968, p. 43.
9 Ibid., p ; 271
10 Le Monde
11 Israel aujourd’hui, 21-1-1970